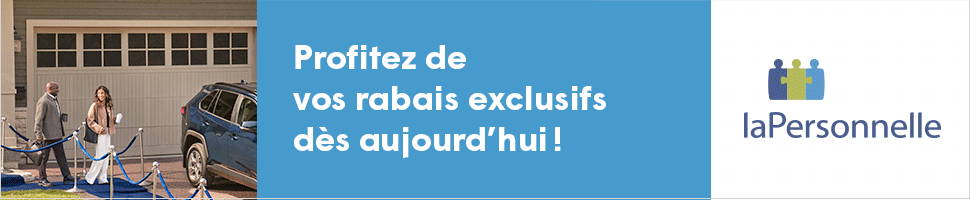International, Syndicalisme
Quand les luttes d’ailleurs inspirent ici
12 novembre 2025
Alors que le Québec s’apprête à vivre un resserrement inédit du droit d’expression syndicale et l’annonce d’un projet de loi visant à restreindre le champ d’action syndicale, la CSQ a choisi d’élargir le regard. En invitant des leaders syndicaux du Portugal, d’Italie et d’Écosse, la Centrale a tenu une table ronde qui a mis en lumière une leçon de courage et d’endurance collective.
Par Félix Cauchy-Charest, conseiller CSQ
Partout, les gouvernements cherchent à museler la voix des travailleuses et des travailleurs. Au Portugal, en Italie, en Écosse comme au Québec, le même refrain résonne : restreindre le droit de grève, encadrer la parole, limiter la mobilisation.
Au Portugal, par exemple, Manuela Mendonça, de la Federação Nacional dos Professores (FENPROF) raconte que « le gouvernement a élargi les services minimums à ce qu’il appelle la garde des enfants ». Cette obligation de maintenir certains services en cas de grève rappelle le controversé projet de loi no 89 du ministre du Travail, Jean Boulet.
En Écosse, Adam Sutcliffe du Educational Institute of Scotland (EIS), évoque, quant à lui, la loi Trade Union Act de 2016, qui impose des seuils de participation draconiens : « Pour déclencher une grève, il faut un vote postal avec plus de 50 % de participation. »
Et en Italie, Salvatore Marra de la Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), rappelle qu’« après les années de dictature, le droit de grève est redevenu un droit constitutionnel, mais il est aujourd’hui attaqué par les mêmes forces politiques qui jadis en avaient peur ».
Des échos au Québec
Ces propos trouvent un écho troublant au Québec, où le gouvernement de François Legault cherche à redéfinir les règles du jeu démocratiques. Avec sa réforme du régime syndical, le gouvernement vise à interdire aux organisations syndicales de se prononcer sur des enjeux politiques ou sociaux, autrement dit, de parler de ce qui affecte réellement leurs membres : la santé, l’éducation, la justice sociale, l’équité salariale, le vivre-ensemble, etc.
La tentation de réduire le syndicalisme à un simple rôle de négociateur salarial n’est pas nouvelle, mais elle prend une ampleur inquiétante. Et c’est justement ce contre quoi les syndicats européens invitent les syndicats québécois à se battre.
Trois contextes, même combat
La représentante et les représentants des syndicats européens invités par la CSQ viennent d’horizons différents, mais leurs réalités se rejoignent. Au Portugal, la montée de l’extrême droite se double d’une volonté de fragiliser les services publics. La FENPROF y oppose une vision claire : défendre l’éducation publique, les droits humains et la démocratie. En Italie, le gouvernement Meloni gouverne avec une rhétorique antisyndicale assumée, déclarant illégales des grèves générales pour défendre les services publics. Et en Écosse, malgré un gouvernement de centre gauche favorable à l’indépendance, le personnel enseignant doit encore mener des campagnes coûteuses et épuisantes pour obtenir des hausses salariales.
Ici comme ailleurs, les syndicats sont confrontés à la même équation : maintenir la mobilisation dans un contexte de répression subtile, parfois administrative, parfois médiatique.
Adam Sutcliffe évoque la campagne Pay Attention, menée en Écosse, qui a permis de faire plier le gouvernement en 2023 : « Cinq jours de grève totale, des couleurs vives, des enseignantes et enseignants unis. » Une mobilisation qui a fait ses preuves, raconte-t-il. Au Portugal, la FENPROF a organisé une caravane qui a traversé le pays pendant 18 jours pour promouvoir l’école publique et sensibiliser la population aux enjeux. Et en Italie, la CGIL a mené des grèves générales contre les coupes budgétaires…, mais aussi pour la paix à Gaza et la défense des droits de la personne, mobilisant plus de deux millions de travailleuses et de travailleurs.
« C’est absurde de dire qu’un syndicat ne devrait pas faire de politique, a martelé Salvatore Marra. Défendre les services publics et les droits des personnes, c’est profondément politique. »
L’autonomie syndicale comme rempart
Autre point commun : tous refusent la confusion entre engagement politique et partisanerie. Au Portugal, comme en Italie et en Écosse, les syndicats maintiennent leur autonomie vis-à-vis des partis, tout en revendiquant haut et fort leur droit d’intervenir dans le débat public. « Nous ne soutenons pas de parti, a expliqué Manuela Mendonça. Nous parlons à tous, sauf à l’extrême droite. Nous faisons de la politique, mais pas de la politique partisane. »
Cette nuance essentielle est au cœur du combat québécois actuel : défendre le droit des syndicats de parler du monde dans lequel vivent leurs membres, sans être accusés de partisanerie ou d’ingérence dans le processus électoral.
Un appel à la solidarité internationale
Le message des trois délégués syndicaux converge : alors que les offensives antisyndicales circulent d’un pays à l’autre, portées par les mêmes intérêts économiques et la même volonté d’affaiblir les contre-pouvoirs, aucune lutte syndicale n’est locale.
Cette table ronde avec la représentante et les représentants syndicaux de l’international, organisée dans le cadre du dernier conseil général de la CSQ, n’a pas seulement permis de constater des similitudes : elle a offert une boussole. Les personnes invitées ont montré qu’il est possible de résister dans la durée, d’allier la rue, la négociation et la proposition politique. Elles ont rappelé que la mobilisation créative, la solidarité entre secteurs et la pédagogie publique sont des armes redoutables.
En clôturant la rencontre, le président de la CSQ, Éric Gingras, a souligné l’importance de parler aux collègues ailleurs dans le monde : « Nos gouvernements semblent, eux, très bien collaborer à l’international. À nous de faire la même chose. »