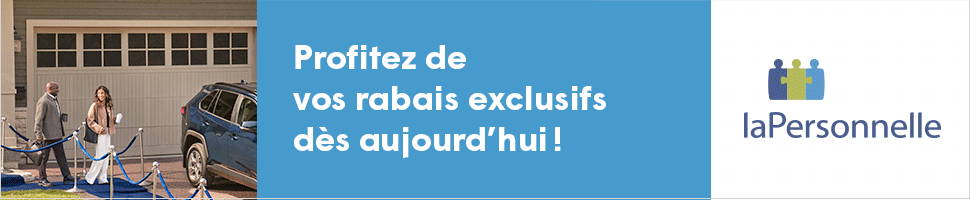La prévention, la sensibilisation, l’intervention et le soutien sont essentiels dans la lutte contre la violence en milieu scolaire. C’est l’affaire de toutes et tous. Chaque intervenante et chaque intervenant, tout comme le centre de services scolaire ou la commission scolaire, joue un rôle clé et déterminant dans cette lutte. Cette section présente des informations utiles afin que les initiatives mises en place dans les milieux portent leurs fruits et qu’un climat sain et sécuritaire s’installe.

-
Reconnaitre les différentes formes de violence en milieu scolaire
La violence à l’école peut revêtir diverses formes, et les moyens utilisés par celles et ceux qui commettent des gestes de violence changent et évoluent selon les époques. La violence peut être perpétrée autant par les élèves, les parents, les collègues que par le personnel de direction.
La violence physique
Elle porte atteinte à l’intégrité physique d’une personne. Elle peut causer des blessures et laisser des séquelles physiques et psychologiques à long terme.
Exemples :
- Mordre
- Bousculer
- Frapper
- Gifler
- Étrangler
- Lancer des objets
- Égratigner, érafler
- Pincer
- Cracher
- Tirer les cheveux
- Frapper sur un mur ou un objet
La violence verbale
La violence verbale est souvent utilisée pour intimider, humilier ou contrôler une autre personne. Elle peut viser à créer une tension chez l’autre, à le maintenir dans un état de peur.
Exemples :
- Crier, hurler
- Blasphémer à l’endroit d’une personne
- Lancer des insultes
- Tenir des propos injurieux, dégradants ou humiliants
- Menacer
- Tenir des propos agressifs dans les communications (exemples : appels, courriels)
La violence psychologique
La violence psychologique vise généralement à exercer un contrôle sur une personne. Elle se manifeste par des attitudes ou des propos méprisants, humiliants, qui influencent la perception qu’une personne a de sa propre valeur. Elle s’exprime parfois par un comportement punitif, qui consiste à ignorer la présence de l’autre ou à refuser de communiquer. Cette forme de violence est subtile et ne se traduit pas toujours verbalement. Les termes intimidation et harcèlement sont fréquemment utilisés pour désigner ce type d’agression.
L’intimidation se définit comme un comportement visant à faire peur, à menacer ou à contraindre une personne à agir contre son gré. Le harcèlement, pour sa part, est un type d’intimidation pratiqué à répétition sur la victime.
Il s’agit de comportements abusifs commis de façon unilatérale par une ou plusieurs personnes, sous forme d’actions, de gestes, de paroles ou d’écrits dirigés contre un individu. Leur répétition a pour conséquence l’atteinte à l’intégrité psychologique ou physique de la victime, qui éprouve généralement un sentiment d’impuissance vis-à-vis de la situation.
Un seul geste d’intimidation peut, toutefois, suffire à causer un préjudice à la victime. Il est donc essentiel d’intervenir dès les premières manifestations afin de prévenir une escalade vers le harcèlement.
Dans de telles situations, la victime éprouve souvent de la difficulté à se défendre. Un rapport de force s’installe alors, où la ou les personnes ayant commis l’agression cherchent à dénigrer ou à discréditer la personne ciblée.
Exemples :
- Tenir des propos dévalorisants, humiliants, vexatoires, grossiers
- Répandre des rumeurs ou de fausses allégations
- Isoler une personne (nier sa présence, l’éloigner, ne pas lui adresser la parole)
- Critiquer de manière insistante
- Discréditer et faire douter la personne d’elle-même (dénigrer)
- Empêcher une personne de s’exprimer (l’interrompre, lui interdire de parler aux autres)
- Proférer des menaces verbales, écrites ou gestuelles
- Exercer du chantage
- Vandaliser, saboter, voler
La violence à caractère sexuel
Depuis l’adoption de la Loi visant à prévenir et à combattre le harcèlement psychologique et la violence à caractère sexuel en milieu de travail, ce type de violence est encadré dans plusieurs lois régissant le travail, comme la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST), la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) ou encore la Loi sur les normes du travail (LNT).
D’ailleurs, dans la LSST, on définit la violence à caractère sexuel comme étant :
Toute forme de violence visant la sexualité ou toute autre inconduite se manifestant notamment par des gestes, des pratiques, des paroles, des comportements ou des attitudes à connotation sexuelle non désirés, qu’elles se produisent à une seule occasion ou de manière répétée, ce qui inclut la violence relative à la diversité sexuelle et de genre.
Exemples :
- Manifester un intérêt sexuel non désiré (commentaires, allusions, blagues)
- Établir un contact physique non consenti
- Solliciter ou regarder la personne de manière insistante
- Proférer des insultes sexistes, homophobes, transphobes ou tenir des propos grossiers
- Faire des appels ou envoyer des messages textes, des sextos ou des courriels à connotation sexuelle
- Effectuer des attouchements non désirés
- Diffuser des images à connotation sexuelle par tout moyen (technologique ou autre)
- Commettre une agression sexuelle
La cyberviolence
On désigne sous les termes cyberviolence ou cyberintimidation le fait d’utiliser les réseaux sociaux ou d’autres outils numériques pour porter atteinte à la dignité d’autrui.
Exemples :
- Envoyer des courriels, des messages textes blessants ou menaçants ou en publier sur les réseaux sociaux
- Faire circuler des rumeurs, des secrets ou des potins sur les réseaux sociaux, par courriels ou par messages textes
- Photographier ou filmer une personne dans une situation embarrassante et partager les photos ou les vidéos avec d’autres personnes, à son insu ou sans son autorisation
- Utiliser le mot de passe d’une personne pour accéder à son compte de réseau social afin d’y afficher des contenus embarrassants ou choquants
- Diffuser des renseignements sur une personne dans le but que des gens s’en prennent à elle ou afin de compromettre son sentiment de sécurité
Les incivilités
Les incivilités, souvent perçues comme moins extrêmes ou directes, peuvent tout de même constituer une forme de violence. Elles sont souvent définies comme des comportements, commis consciemment ou non, qui enfreignent les règles de civilité, de respect mutuel ou de normes sociales.
Bien que les incivilités puissent paraitre banales de prime abord, lorsqu’elles sont répétées, leurs effets peuvent être aussi importants sur les personnes et les milieux que d’autres formes de violence.
Exemples :
- Insulter, faire preuve d’impolitesse
- Poser des gestes désobligeants
- Utiliser un cellulaire en classe à un moment inopportun
- Engendrer des comportements perturbateurs (exemples : faire du vacarme ou de l’obstruction, interrompre les propos systématiquement)
- Tenir des propos provocateurs, condescendants ou vexatoires
- Manquer de respect à quelqu’un, manquer de savoir-vivre
- Hausser la voix, crier, user de sarcasme
- Utiliser les majuscules dans les échanges écrits
-
Comprendre les causes de la violence
Depuis quelques années, le personnel de l’éducation remarque une montée importante de la violence dans les établissements.
Afin de prévenir la violence, d’intervenir efficacement lorsqu’elle survient et de soutenir les victimes, les témoins et les personnes ayant commis l’agression, il est essentiel de bien comprendre ses causes.
Une multitude de facteurs peuvent expliquer pourquoi certaines personnes posent des gestes de violence. Ces facteurs, qu’ils soient sociaux, familiaux, environnementaux ou individuels, interagissent souvent entre eux et s’inscrivent dans un processus de développement complexe.
Des facteurs sociaux et familiaux
La violence est un phénomène qui fait partie de la vie en société. Ce qui se produit hors des murs des établissements influence, à coup sûr, ce qui se produit à l’intérieur. Selon les époques et le lieu où l’on se trouve, la société dans laquelle on vit peut tendre à se pacifier ou à devenir plus violente. Par ailleurs, certains groupes risquent d’être plus exposés que d’autres à cette violence au sein d’une même collectivité.
Des facteurs familiaux ont aussi été identifiés. Les jeunes qui vivent au sein d’une famille dysfonctionnelle, d’une famille où la violence est présente ou qui subissent de la maltraitance auront davantage tendance à adopter eux-mêmes des comportements violents. La précarité socioéconomique, le manque de discipline ou de supervision parentale ainsi qu’une absence de soutien constant sont aussi des facteurs qui peuvent avoir un effet.
Des facteurs environnementaux
La qualité de l’environnement éducatif de l’établissement est reconnue comme exerçant une influence sur le niveau de violence. Le climat scolaire joue un rôle particulièrement important. S’il est positif, il favorise un plus grand sentiment d’appartenance et de sécurité, ce qui contribue à réduire les gestes de violence. Inversement, un climat perçu comme étant négatif peut les amplifier.
Le climat de l’établissement est influencé par des dimensions tant relationnelles qu’organisationnelles. Sur le plan relationnel, pour bien comprendre comment les comportements violents peuvent se développer au sein de l’école, il est important de porter attention à la dynamique sociale : la qualité de la communication entre les élèves, entre les membres du personnel ainsi qu’entre les élèves et les membres du personnel; la force des liens affectifs qui unissent les personnes et l’existence ou non d’une culture de compétition entre les pairs, d’un esprit de vengeance ou de fausses accusations.
Sur le plan organisationnel, plusieurs facteurs sont déterminants : la mise en place de politiques, la répartition équitable des tâches, la collaboration efficace, la formation pertinente et la présence suffisante de personnel pour répondre à l’ensemble de ces aspects organisationnels ainsi qu’aux besoins d’accompagnement et de soutien des élèves qui ne sont pas comblés autrement. Enfin, l’environnement physique est aussi à considérer. Une surpopulation scolaire, par exemple, peut accroitre les tensions et favoriser les actes violents.
La violence est une des composantes du portrait psychosocial d’un milieu de travail. Ce portait, qui inclut également le soutien des supérieurs et des collègues, et les autres risques psychosociaux, forme le climat de sécurité psychosocial et peut agir comme facteur de risque ou comme facteur de protection pour les travailleuses et travailleurs. En ce sens, il peut être associé à un indice de contagion de la détresse psychologique ou du bien-être au travail.
Des facteurs individuels
Chez les élèves, des facteurs individuels comme le genre, l’âge, l’origine ethnique ou une faible estime de soi peuvent accroitre la probabilité de subir ou de poser des gestes violents. Des différences observables sur les plans physique, psychologique ou comportemental risquent de rendre certains élèves plus vulnérables. Le rejet et l’isolement sont susceptibles, aussi, d’amener une ou un jeune à adopter des comportements violents, comme l’intimidation.
Les membres du personnel peuvent aussi être victimes de violence en raison de leurs caractéristiques personnelles, comme leur origine ethnique, leur orientation sexuelle ou encore leur apparence physique. Le manque de formation adéquate et de préparation du personnel pour faire face aux situations de violence peut le rendre plus vulnérable
Tout comme des individus, également formés et préparés, dans un même environnement de travail, peuvent expérimenter complètement différemment une situation de violence et vivre ou non une lésion professionnelle découlant de celle‑ci. Cette subjectivité personnelle doit donc être prise en compte dans la démarche de prévention, et demeure l’un des facteurs qui rend complexe la formulation d’une définition entièrement objective de la violence.
-
Comprendre les conséquences de la violence
La violence en milieu scolaire entraine des répercussions importantes, tant pour la victime que pour l’ensemble de la communauté scolaire. Il est crucial de reconnaitre, de comprendre et de signaler les gestes violents pour en atténuer les effets.
Conséquences pour la victime et le milieu de travail
La violence peut entrainer des conséquences physiques et psychologiques sur la victime se répercutant autant à l’école que dans d’autres sphères de vie, et pouvant laisser des séquelles à court et à long terme. Ses effets négatifs risquent aussi de se répercuter sur le milieu de travail
Conséquences de la violence Sur le plan physique pour la victime - Problèmes de sommeil
- Fatigue
- Maux de tête et de ventre
- Palpitations
- Troubles digestifs
- Troubles musculosquelettiques
- Blessures
Sur le plan psychologique pour la victime - Augmentation du stress et de l’insécurité
- Sentiment d’incompétence
- Détresse émotionnelle
- Épisodes dépressifs, dépression
- Baisse de l’estime de soi
- Peur du jugement
- Frustration
- Épuisement professionnel
- Idées suicidaires
- Consommation de drogues, d’alcool ou de médicaments
- Lésion psychologique
Sur le travail de la victime dans son milieu de travail - Absentéisme
- Arrêt de travail
- Abandon de la profession
- Crainte et méfiance à l’égard des élèves, des parents, des collègues ou de la direction
- Baisse de motivation
- Perte de crédibilité auprès des élèves, des parents, des collègues et de la direction
- Isolement
- Augmentation des conflits relationnels
- Perte de sens, d’enthousiasme et d’engagement envers la tâche ou les relations
Conséquences sur l’organisation scolaire
Plusieurs conséquences de la violence subie dans le milieu de l’éducation peuvent s’observer sur le plan organisationnel. Il importe de s’en préoccuper et d’intervenir afin de limiter les effets négatifs qui peuvent s’étendre sur l’adulte victime, les élèves, le climat de l’établissement et les relations avec les parents.
Exemples de conséquences négatives liées à l’organisation :
- Des taux élevés d’absentéisme et de roulement du personnel
- Une baisse de cohésion dans l’équipe de travail
- Une augmentation du risque d’erreurs dans l’accomplissement des tâches quotidiennes
S’il s’agit de harcèlement ou d’intimidation de la part de collègues, la formation de clans risque de miner l’ambiance générale et les relations interpersonnelles. L’agressivité entre les membres du personnel devient aussi un effet négatif important, de même que la détérioration du lien de confiance avec l’employeur. L’atteinte de l’image ou de la réputation de l’établissement peut aussi être un effet secondaire important à considérer, puisque l’on sait que cette réputation prendra des années à se rétablir.
-
Agir pour prévenir la violence
Plusieurs causes de la violence en milieu scolaire trouvent leur origine à l’extérieur des établissements d’enseignement. Cependant, le personnel scolaire (direction, personnel enseignant, professionnel et de soutien) peut contribuer positivement à la prévention et à la réduction de la violence. À cet égard, la collaboration entre les membres du personnel est essentielle.
Selon leurs rôles et leurs responsabilités, diverses actions, collectives ou individuelles, peuvent être entreprises afin de prévenir les manifestations de violence ou encore pour en diminuer les conséquences. Chaque milieu est invité à identifier ses priorités et à mettre en place les ressources nécessaires pour qu’elles portent leurs fruits, ainsi qu’à consigner le tout dans un programme de prévention adapté au milieu.
Comme pour tout enjeu social, la prévention demeure incontournable. Une approche strictement répressive ne peut régler qu’une partie des problèmes de violence.
Mise en œuvre de politiques, de plans et de mesures
Les membres du personnel, selon leurs responsabilités respectives, ont un rôle à jouer dans l’élaboration de balises et de mécanismes visant à soutenir la prévention et l’intervention en matière de violence, notamment.
Exemple :
- Politiques et codes de conduite
- Plans de lutte contre l’intimidation et la violence pour le milieu scolaire
- Règles de conduite et mesures de sécurité de l’école et règles de fonctionnement du centre
- Mesures, procédures ou protocoles d’intervention, d’urgence et de suivi
- Sensibilisation, communication active de ces moyens et implication des élèves à ceux-ci
- Mécanismes de participation du personnel
- Programmes de prévention
- Liens accrus avec les instances scolaires, les conseils d’établissement et d’administration, ainsi qu’avec les ressources de la communauté
Objectifs proposés :
- Agir collectivement sur le climat scolaire
- Prévenir et réduire les situations de violence à l’école
- Améliorer le sentiment de sécurité et d’appartenance à l’école
- Favoriser les relations interpersonnelles saines, la collaboration et le soutien social du personnel scolaire et des élèves
Dans les établissements scolaires, les plans de lutte contre l’intimidation et la violence, les règles de conduite (écoles) et les règles de fonctionnement (centres) sont élaborés avec la participation des membres du personnel avant d’être déposés au conseil d’établissement pour adoption ou approbation (article 77 de la Loi sur l’instruction publique [LIP] et article 63.4 de la Loi sur l’enseignement privé [LEP]).
Actions concertées et complémentaires de nature préventive et éducative pour contrer la violence
Certaines pratiques préventives sont liées au rôle du personnel scolaire, à sa dimension relationnelle et au développement des compétences socioémotionnelles chez les élèves, selon les rôles et les responsabilités de chacune et chacun.
Des valeurs, des attitudes et des actions contribuent au bien-être à l’école grâce à des pratiques d’intervention universelles dont les objectifs peuvent être de :
- favoriser une meilleure connaissance des élèves;
- développer des relations positives, l’autonomie et le sentiment de compétence des élèves.
Divers programmes et initiatives favorisent le développement de compétences socioémotionnelles et d’habiletés sociales, comme la communication, la coopération, l’aide, le partage, l’empathie, l’autocontrôle comportemental, les conduites pacifiques, la résolution de problèmes ou de conflits interpersonnels, la régulation cognitive, les comportements attendus et le modelage.
L’utilisation constructive des situations et des comportements est aussi une avenue qui peut être envisagée pour la prévention et la réduction des comportements violents.
Exemple :
- Porter attention aux signaux, même faibles, de mal-être chez les élèves
- Renforcer les comportements attendus en groupe
- Considérer les erreurs de conduite comme des situations d’apprentissage social
- Favoriser des interventions éducatives graduées, selon la maturité des élèves, la gravité du geste et en respect de la dignité de toutes et tous
- Soutenir le développement de la compétence numérique, notamment pour prévenir la cyberviolence
Des rencontres en équipe-école contribuent à enrichir les analyses des situations et à faciliter la concertation entourant les actions et les stratégies à mettre en place. La fréquence de ces rencontres doit tenir compte des besoins de chaque milieu.
Plusieurs pratiques de prévention et d’intervention peuvent être mises en place pour soutenir les élèves qui ont besoin d’aide supplémentaire, selon les rôles et les responsabilités des membres du personnel.
Exemple :
- Pratiques d’intervention spécifiques et ciblées impliquant les membres du personnel concernés, telles: soutien et mesures, plans d’intervention, stratégies d’enseignement, intensification de certaines interventions déjà en place, etc.
- Collaboration entre les membres du personnel attitré, des différentes catégories, et les partenaires gravitant autour de l’élève (équipe-école, collaboration interdisciplinaire ou multidisciplinaire entre le personnel scolaire concertation avec le réseau de la santé et des services sociaux, etc.)
- Référencement ou encouragement de l’élève à participer à des ateliers de sensibilisation ou de soutien en groupe (gestion de la colère)
- Participation aux mesures individualisées destinées à l’élève (niveau 3 des systèmes de soutien à paliers multiples) (plan d’intervention personnalisé ou intersectoriel, protocole-élève, soutien psychosocial adapté, etc.)
- Encouragement de l’implication de la famille et accompagnement de celle-ci
Une offre de formation et un accompagnement bien adaptés aux besoins du personnel l’aident à s’approprier plusieurs des aspects, des contenus et des stratégies d’intervention abordés dans ce guide, à accroitre sa confiance et à mieux agir en prévention comme en situation de crise.
-
Intervenir pour gérer les situations de violence
Si l’environnement socioéducatif ne réagit pas promptement aux conduites inappropriées et ne propose pas de solutions proactives, les situations de violence auront tendance à se reproduire.
La prévention demeure la meilleure solution, mais il arrive que malgré les efforts déployés, certains événements violents surviennent. Pour gérer la situation de crise adéquatement, différentes possibilités peuvent être envisagées selon la nature de la situation, l’appréciation du potentiel de dangerosité, le degré d’alerte ainsi que l’évolution de la situation de crise.
Le choix des actions et des interventions doit toujours tenir compte des objectifs de sécurité, de l’éthique et des responsabilités des différents acteurs.
Interventions de désamorçage
Objectifs proposés :
- Freiner l’escalade des comportements
- Intervenir le plus tôt possible
- Éviter la crise
- Rétablir le calme
L’escalade d’un comportement ou la désorganisation de l’élève peut mener à une manifestation comportementale dangereuse. Il peut être utile de connaitre les facteurs déclencheurs et les signes précurseurs.
Facteurs déclencheurs Signes précurseurs - Sentiment d’injustice ou de perte de pouvoir personnel
- Évocation émotionnelle (la situation ressemble à une situation désagréable vécue par le passé et fait revivre à la personne des émotions fortes)
- Agent stressant aigu (douleur, intoxication, peur intense, crise situationnelle, etc.)
- Problème de santé physique ou douleur
- Accumulation de frustrations
- Exagération ou changement notable dans le comportement : tête ou épaules vers l’arrière pour impressionner, regard froid, mains sur les hanches, doigt qui pointe, etc.
- Agitation psychomotrice : déplacement, agitation des bras ou des mains, tremblements, etc.
- Réactions physiologiques : respiration rapide, sudation, visage rouge ou blanc, etc.
- Signes de frustration : plaintes, jérémiades, haussement du ton de la voix, expressions ou actions agressives (lèvres serrées sur les dents, menace du poing, etc.)
Manifestations comportementales de l’élève en situation de crise - Tension émotive ou grande agitation
- Communication agressive et absence d’inhibition sociale (exemples : blasphémer, crier, insulter)
- Collaboration conditionnelle ou réfractaire
- Intimidation psychologique
- Perte de contrôle
- Comportement destructeur (exemples : lancer ou briser des objets)
- Résistance active
- Agression physique, coup ou assaut grave
- Menace exceptionnelle
Source : MASSÉ, Line, Martine VERREAULT et Claudia VERRET (2011). Mieux vivre avec le TDAH à la maison : programme pour aider les parents à mieux composer avec le TDAH de leur enfant au quotidien, Montréal, Chenelière Éducation, 552 p.
Une fois le comportement perturbateur ou de tension identifié, il est recommandé d’intervenir en privé auprès de l’élève, si possible. Tout en favorisant sa collaboration, cette pratique permet d’éviter de lui accorder une attention particulière devant toute la classe, ce qui risquerait de maintenir le comportement perturbateur.
En situation de violence, certaines stratégies peuvent favoriser la désescalade et le retour au calme.
Exemples :
- Rappeler les règles de comportements et de conduites attendus
- Formuler des directives simples et impliquer l’élève dans la recherche de solutions
- Maintenir une distance physique sécuritaire avec l’élève et les autres personnes présentes
- Tenter de valider les émotions de l’élève, sans pour autant excuser ses actions et ses manifestations d’agressivité verbale
- Retirer l’élève du local (retrait préventif) et lui offrir un moment pour se calmer (si nécessaire et si possible)
- Reprendre le contrôle du groupe
- Prévoir, avec l’élève, un moment pour revenir sur l’événement, dans une perspective de responsabilisation et de prévention
Interventions lors d’une situation de violence
Voici quelques pistes de réflexion et d’action lorsque survient une situation de violence :
- Évaluer les risques, le niveau de dangerosité de l’élève ainsi que sa propre capacité à intervenir, à demander du soutien ou à prendre le relais, si nécessaire
- Considérer le contexte, la gravité et la fréquence des gestes
- Se recentrer sur son propre rôle et suivre les procédures prévues (mesures d’urgence, protocole-école, etc.)
- Chercher à établir un contact avec l’élève en crise
- Annoncer à l’élève ses intentions, ses actions et ses déplacements
- Sécuriser l’environnement en retirant les objets à proximité
- Assurer la sécurité du groupe en en éloignant l’élève, si possible
- Appliquer les mesures prévues au protocole-élève (plan d’intervention, mesures de contrôle), au code de vie, au plan de lutte et au protocole-école (sortie de l’élève ou des élèves du local, mise en retrait ou isolement, transmission de l’information aux parents, etc.)
Les mesures de contrôle ne doivent être utilisées qu’en dernier recours, dans un contexte de risque ou de danger imminent qui ne permet pas d’interventions alternatives. Il est conseillé de se référer au Cadre de référence sur les mesures de contrôle en milieu scolaire.
-
Soutenir à la suite d’une situation de violence
Le soutien offert aux élèves et au personnel scolaire à la suite d’une situation de violence est essentiel.
Interventions à la suite d’une situation de violence
- Allouer un temps à l’élève pour décompresser dans un endroit sécuritaire et la ou le rencontrer lorsqu’elle ou il est d’accord pour discuter.
- Effectuer un retour sur l’événement avec l’élève en adaptant ses actions aux besoins ou aux réalités de celui-ci.
- Intervenir auprès des élèves de la classe : retour sur l’événement, réponse aux questions, expression des émotions, etc. (tous les membres du personnel concernés, selon ce qui est prévu dans le protocole-école).
- Informer les parents de la situation, les impliquer dans la recherche de solutions et le suivi des engagements de l’élève.
- Effectuer une réflexion personnelle sur les interventions réalisées.
- Analyser les informations recueillies, les circonstances, les besoins non répondus, les facteurs déclencheurs ou précipitants afin de favoriser la compréhension de l’événement, les apprentissages à en tirer, et de déterminer les mesures de soutien préventives et les interventions à mettre en place, à ajuster ou à intensifier.
- S’assurer que toutes les intervenantes et tous les intervenants de l’élève sont informés pour garantir la cohérence des moyens d’action et adapter les plans et les protocoles de l’élève instigateur.
- Évaluer et ajuster le protocole-école, si nécessaire : adaptation des interventions pour mieux répondre aux besoins des élèves, renforcement de la sécurité du personnel, vérification de la disponibilité du personnel d’urgence désigné, etc.
- Assurer un suivi du bien-être et de la régulation des actions auprès de l’élève et du personnel impliqués, quelques semaines après l’événement.
Pratiques suggérées lors d’une suspension ou d’un arrêt de scolarisation
Plusieurs recherches ont démontré l’inefficacité de l’utilisation de la suspension scolaire en tant que mesure punitive visant à éliminer des comportements inappropriés, allant même jusqu’à entrainer un durcissement de la relation entre l’école, l’élève et ses parents.
Des pratiques de prévention dans les milieux constituent une alternative à la suspension scolaire, notamment à l’externe, bien que celle-ci soit encore utilisée à ce jour. Dans ce contexte, certaines pratiques viennent amoindrir les potentielles conséquences négatives lors de la suspension des élèves.
Maintenir un lien avec l’élève malgré l’événement ou les récidives
La direction peut :
- clarifier les raisons du temps d’arrêt auprès de l’élève et des parents en laissant ceux-ci s’exprimer;
- informer l’élève et les parents de la démarche à suivre, en vue de la réintégration, et des comportements attendus;
- encourager la collaboration des parents et leur soutien quant aux mesures mises en place;
- assurer un accueil de l’élève et des parents, à son retour.
Le personnel attitré à l’élève peut :
- planifier l’envoi de travaux scolaires afin d’éviter que l’élève prenne du retard;
- identifier une personne désignée et prévoir des moments à l’horaire pour garder contact avec l’élève (appels, supervision ou correction de travaux, etc.);
- se concerter pour ajuster les protocoles et les plans de l’élève lorsque nécessaire;
- consulter l’élève ainsi que ses parents sur les modifications et les mesures de soutien proposées;
- rassurer l’élève, lors de son retour, en rappelant la nuance entre son comportement et sa personne;
- accompagner l’élève dans une démarche réparatrice, lorsqu’indiqué.
-
Collaborer avec les parents et les partenaires externes
Tous les acteurs de l’éducation reconnaissent que la collaboration est essentielle pour répondre aux besoins des élèves et soutenir leur épanouissement. La collaboration entre l’école, les familles et les partenaires de la communauté joue un rôle dans le bien-être et la réussite éducative des élèves, même si les conditions nécessaires à cette collaboration ne sont pas toujours réunies.
Les possibilités de collaboration entre le personnel scolaire et les divers acteurs présents auprès des jeunes peuvent favoriser la prévention de la violence, faciliter les interventions et améliorer les encadrements.
Famille
Les parents représentent les premiers éducateurs de leurs enfants. Leur communication avec l’école, leur implication ainsi que leur participation sont des facteurs déterminants dans le parcours scolaire de l’élève. Une relation de confiance et une communication positive entre l’école et les familles sont essentielles à une collaboration harmonieuse et constructive au bénéfice de l’élève.
Cela dit, cette collaboration doit reposer sur un respect mutuel et sur des actions planifiées au sein de l’école. Lors d’interventions en contexte de violence, le soutien des parents peut considérablement renforcer les mesures et les moyens mis en œuvre.
Bien que les parents ne soient pas tenus de divulguer aux organismes et au personnel scolaire les principales informations relatives à l’élève et à l’environnement familial (demandes et suivis en santé et services sociaux, signalements, etc.), ces renseignements peuvent permettre un meilleur suivi scolaire de l’élève et une meilleure collaboration avec l’équipe‑école.
La Fédération des comités de parents du Québec propose le Guide pour accompagner les parents dont les enfants sont confrontés à des situations de violence ou d’intimidation en milieu scolaire. Ce guide vise à aider les parents à résoudre et à prévenir des situations problématiques de violence ou d’intimidation dans un contexte de collaboration avec le milieu scolaire. Il répertorie les rôles que peuvent jouer les parents, les recours accessibles et les conduites à adopter.
Réseau de la santé et des services sociaux
La collaboration entre le réseau de la santé et des services sociaux et le milieu scolaire est soutenue par une entente de complémentarité des services entre les ministères concernés (ministère de l’Éducation et ministère de la Santé et des Services sociaux).
Cette entente inclut les partenariats entre les directions de santé publique, les centres locaux de services communautaires (CLSC), les centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) ou centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS), ainsi que les centres et les directions de la protection de la jeunesse. La collaboration entre ces différents acteurs peut être précieuse pour prévenir des situations de violence en milieu scolaire et pour soutenir l’intervention.
Le déploiement de l’entente, les pratiques et les services offerts et proposés aux familles varient selon les régions. Ils visent notamment une meilleure cohérence des actions, et la continuité et la complémentarité des services entre le milieu scolaire, la maison et les services sociaux
Outils à télécharger

Guide de la CSQ
Pour éviter que la violence laisse des traces