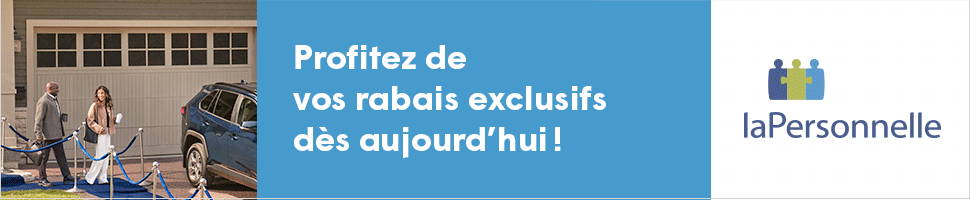Actualités, Santé
SIIIEQ-CSQ : vers un été plus serein pour les soins de santé malgré les défis
16 juillet 2025
Par Léanne Fiset-Gingras, stagiaire aux communications
Une région sous pression estivale
En Gaspésie, la saison estivale est toujours un défi de taille pour le réseau de la santé. Avec sa vocation touristique, la région voit sa population doubler pendant l’été, exerçant une pression considérable sur les urgences et les établissements de santé.
« Il y a une énorme pression sur le territoire, mais aussi sur nos établissements », explique Pier-Luc Bujold, président du Syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l’Est du Québec (SIIIEQ-CSQ). « Quand la population double, il faut être prêt. »
Une amélioration notable du climat de travail
Pourtant, malgré les appréhensions, une certaine amélioration du climat de travail a tout de même été observée au cours des dernières années. « L’été passé a été la meilleure période estivale des 15 dernières années », souligne Pier-Luc Bujold. Il attribue cette réussite à plusieurs mesures mises en place pour stabiliser le personnel et réduire la pression.
L’adoption de l’horaire 7/7 et d’horaires hybrides (incluant des quarts de 12 heures, et une forme d’autogestion) a notamment contribué à offrir une meilleure stabilité aux équipes. « Cela permet aux gens d’avoir des périodes de travail, mais aussi des congés. Ça apporte un cycle plus stable », précise le président.
Moins de TSO et plus de respect pour le personnel
Considéré comme l’un des plus grands irritants dans le réseau, le temps supplémentaire obligatoire (TSO), a aussi reculé grâce à des ententes négociées. Des primes de 5 % sur toutes les heures régulières travaillées en périodes estivales et une prime de 10 % sur toutes heures supplémentaires travaillées en période estivale ont été mises en place. De plus, un taux double sur les heures supplémentaires travaillées les fins de semaine a été établi.
« Dès que ce n’est pas imposé, ce n’est plus une contrainte psychologique », explique Pier-Luc Bujold. « Oui, la fatigue est là, mais les gens se sentent respectés. Ça change tout. »
Cette approche plus humaine contribue à limiter le recours au TSO et favorise une meilleure qualité de vie au travail, ce qui est essentiel pour retenir le personnel en région.
Des projets concrets pour l’attraction et la rétention
Pour contrer la pénurie persistante de personnel, la région a également pu bénéficier de budgets dédiés à l’attraction et à la rétention.
« On a pu lancer des projets », se réjouit Pier-Luc Bujold. Parmi eux : des bourses pour encourager les jeunes à entreprendre des études en soins infirmiers ou pour aider les infirmières et infirmiers auxiliaires à retourner sur les bancs d’école.
« Ça ne réglera pas tout demain matin », reconnaît-il, « mais c’est un pas dans la bonne direction. »
Main-d’œuvre indépendante et adaptation du territoire
La gestion de la main-d’œuvre indépendante (MOI), redevenue courante pendant la pandémie, demeure un enjeu. Même si la situation s’est améliorée pour les infirmières auxiliaires, certains secteurs en soins infirmiers en dépendent encore. L’objectif reste de réduire ces contrats au minimum d’ici 2026, comme le prévoit la loi.
Autre élément crucial : l’intégration de la main-d’œuvre immigrante. La Gaspésie mène un projet pilote pour recruter des infirmières diplômées hors Québec (IDHC), souvent originaires du Nord de l’Afrique. Ces travailleurs représentent déjà plus de 6 % des membres, même si plusieurs n’ont pas encore la résidence permanente.
« Il y a beaucoup de défis, surtout pour le logement », note Pier-Luc Bujold. « On veut attirer du monde, mais il faut qu’ils puissent se loger et avoir accès à des garderies. Il y a tout un travail d’adaptation à faire avec le territoire. »
Une gestion plus humaine et consultative
Au-delà des chiffres et des programmes, la relation entre le syndicat et le CISSS de la Gaspésie a elle aussi évolué. Après une période difficile marquée par des plaintes, des enquêtes et même le congédiement d’une PDG à l’Assemblée nationale, un nouveau climat de collaboration s’est instauré.
« Avant, c’était très top-down », se rappelle Pier-Luc Bujold. « Aujourd’hui, l’organisation a plus tendance à consulter les gens. Et ça change beaucoup de choses. »
Cette approche, qui semble s’orienter vers plus d’ouverture, a contribué à améliorer les conditions de travail et à renforcer la confiance au sein des équipes, même si des incertitudes demeurent, notamment avec la création de Santé Québec et les pressions budgétaires persistantes.
Un été sous le signe de la prudence et de l’espoir
Malgré tous ces progrès, Pier-Luc Bujold reste lucide. « J’ai un regard positif sur l’été, mais on n’est pas à l’abri », reconnaît-il. « C’est sûr qu’il y aura des enjeux qu’on n’aura pas vus venir. Mais globalement, on avance dans la bonne direction. »
En Gaspésie, on aborde donc la haute saison avec prudence, mais aussi avec espoir, conscient que le chemin vers des services de santé plus accessibles et plus humains passe par un engagement constant et un dialogue ouvert entre tous les acteurs du réseau.