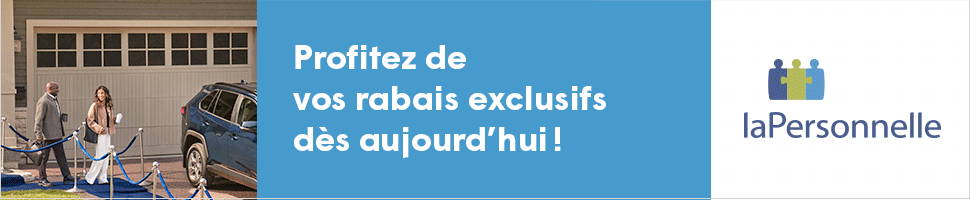Société
Personnes aînées : la bientraitance, au-delà de la bienveillance
1 octobre 2025
Le Québec fait face à une transformation démographique majeure. Le vieillissement de sa population, déjà amorcé, s’accélère, ce qui entraîne de nouveaux défis pour le respect et la protection des personnes aînées en situation de vulnérabilité. Dans ce contexte, il ne suffit plus d’être bienveillant. Pour prévenir la maltraitance et garantir la dignité des personnes aînées, il faut aller plus loin et miser sur la bientraitance.
Par Samuel Labrecque, conseiller AREQ
Selon les plus récentes données de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), la proportion de personnes âgées de 65 ans et plus ne cesse d’augmenter et devrait atteindre une personne sur quatre d’ici 2031. Cette évolution démographique soulève d’importants enjeux sociaux et collectifs : il faudra adapter les services, renforcer le soutien offert aux personnes aînées et prévenir les situations de vulnérabilité. C’est dans cette perspective que la bientraitance apparaît comme un levier essentiel, puisqu’elle dépasse la simple intention de bienveillance individuelle pour s’incarner en actions et pratiques structurées à l’échelle collective.
La maltraitance : un problème bien réel
La maltraitance envers les personnes aînées se définit comme « un geste singulier ou répétitif, ou une absence d’action appropriée, qui se produit dans une relation où il devrait y avoir de la confiance, et qui cause du tort ou de la détresse à la personne ».
Une enquête menée en 2019 a révélé que la maltraitance psychologique est la plus fréquemment vécue à domicile par les personnes aînées québécoises. Les facteurs de risque sont l’isolement, la perte d’autonomie, la précarité financière et la présence de troubles cognitifs.
De la bienveillance à la bientraitance
Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) définit clairement la bientraitance et la distingue de la simple bienveillance : « Une approche valorisant le respect de toute personne, de ses besoins, de ses demandes et de ses choix, y compris ses refus. Elle s’exprime par des attentions et des attitudes, un savoir-être et un savoir‑faire collaboratifs, respectueux des valeurs, de la culture, des croyances, du parcours de vie et des droits et libertés des personnes. Elle se construit par des interactions et une recherche continue d’adaptation à l’autre et à son environnement. Elle s’exerce par des individus, des organisations ou des collectivités qui, par leurs actions, placent le bien-être des personnes au cœur de leurs préoccupations. »
- Bienveillance : attitude empreinte d’attention, de gentillesse, d’empathie et de sollicitude. C’est une disposition affective ou une intention louable. Par exemple : « Vous devez avoir froid! Je vais vous amener une couverture. » (Bonne intention sans validation du besoin).
- Bientraitance : intention accompagnée de la prise en compte systématique, avant toute action, du point de vue de la personne. Il est crucial de lui demander son avis, de recueillir son accord, de respecter ses décisions, y compris si elles sont négatives. Par exemple : « Avez-vous froid? Voulez-vous une couverture? » (Respect du point de vue, possibilité de choix et dignité conservée).
Les six piliers de la bientraitance
Le MSSS identifie six principes :
- Placer la personne au centre des actions.
- Favoriser l’autodétermination et le pouvoir d’agir.
- Respecter la dignité.
- Promouvoir l’inclusion et la participation sociale.
- Agir avec savoir-être et savoir-faire.
- Offrir un soutien concerté.
Un enjeu collectif
Pour l’AREQ et la CSQ, la distinction entre bienveillance et bientraitance est essentielle. Il importe de promouvoir la bientraitance dans les services publics et dans les milieux éducatifs, en exigeant des moyens concrets et pas seulement des intentions. Car développer des pratiques bientraitantes réduit les risques liés à l’isolement, au manque de ressources et à l’abus de confiance.
Ce texte a été rédigé dans le cadre de la Journée internationale des aînés qui a lieu tous les ans le 1er octobre.