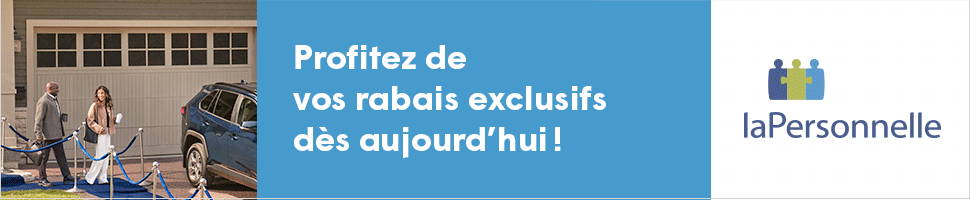Politique
Mémoire sur le projet de loi no 1 — Loi constitutionnelle de 2025
21 novembre 2025
| La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) représente plus de 225 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l’éducation.
La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés en fonction des secteurs d’activité de leurs membres; s’ajoute également l’AREQ, le mouvement des personnes retraitées CSQ. Les membres de la CSQ occupent plus de 350 titres d’emploi. Ils sont présents à tous les ordres d’enseignement (personnel enseignant, professionnel et de soutien), de même que dans les domaines des services éducatifs à la petite enfance, de la santé et des services sociaux (personnel infirmier, professionnel et de soutien, éducatrices et éducateurs), du loisir, de la culture, du communautaire, des communications et du municipal. De plus, la CSQ compte en ses rangs plus de 80 % de femmes et 30 % de jeunes âgés de 35 ans et moins. |
Table des matières
1.1 La participation de la population et l’appropriation constitutionnelle. 3
1.2 Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. 4
1.3 Comment assurer la participation de la population. 4
1.4 L’autodétermination des peuples autochtones. 5
2.1 L’État de droit versus l’État arbitraire. 7
2.2 Souveraineté parlementaire ou monarchisme absolu?. 9
2.3 Le danger de la hiérarchisation des droits. 12
3.1 Protéger la liberté d’association. 12
3.2 Constitutionnaliser formellement les droits économiques et sociaux 13
2.3 Éviter une atteinte au droit des femmes. 14
2.4 Le droit à l’environnement 17
Pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir
— MONTESQUIEU, De l’Esprit des lois, 1748
Introduction
Le projet de loi no 1 — Loi constitutionnelle de 2025 sur le Québec[1] a été présenté à l’Assemblée nationale le 9 octobre dernier par le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette.
Adopter une constitution est un acte historique qui revêt une importance majeure pour le peuple qui l’adopte et pour les générations futures. Une constitution ne doit pas être simplement un énoncé de principes non contraignants pour la législature et le gouvernement. Une constitution, par définition, est la loi fondamentale d’une nation, et aucune autre règle de droit ne peut venir la restreindre. Son adoption et sa modification doivent reposer sur un processus démocratique et le plus participatif qui soit.
L’idée de doter le Québec de sa propre constitution n’est pas nouvelle. Elle permettrait de renforcer la démocratie québécoise, de réunir les principes et les textes fondamentaux de la nation et de mieux protéger les droits et les libertés fondamentales.
À la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), de nombreuses décisions adoptées par le Congrès général affirment l’importance de respecter et de promouvoir la démocratie et les droits et libertés, comme définis par les chartes québécoises et canadiennes et par les textes du droit international en la matière, dont les droits économiques et sociaux, les droits des femmes, l’égalité, l’environnement et les droits des peuples autochtones.
En raison de l’importance historique d’un tel processus et du caractère fondamental de ce type de loi, la CSQ est d’avis que le projet de loi no 1, sur le plan tant du processus que de son contenu, n’est pas à la hauteur pour constituer la loi suprême du Québec. Dans ce mémoire, nous débuterons avec nos préoccupations vis-à-vis du processus proposé dans le cadre de ce projet. Ensuite, nous traiterons des principes fondamentaux devant être protégés et reconnus par la Constitution dans un État de droit. Enfin, nous préciserons quels sont les droits et les libertés qu’une constitution québécoise doit chercher à protéger.
1. Un processus qui manque de légitimité démocratique
La présentation du projet de loi no 1 suscite une vive inquiétude à la CSQ, en ce qui concerne le processus : le projet est réduit au cheminement d’une loi régulière élaborée par quelques individus derrière des portes closes et présenté à moins d’un an de l’élection générale.
- En amont, les consultations semblent avoir été particulièrement minimales. Entre autres, les peuples autochtones n’ont pas été consultés ni inclus d’une quelconque façon dans l’élaboration du projet. Aussi, il a été présenté sans qu’aucun débat ni consensus nationaux n’ait eu lieu quant au processus à mettre en place pour mener à bien une initiative d’une telle ampleur historique. Ce débat n’a pas été fait, et il a été largement souligné que le projet présente un caractère fortement préélectoral, s’inscrivant manifestement dans la volonté du parti au pouvoir de regagner du terrain dans les sondages.
- En aval, aucune tournée ni assemblée sur le terrain n’est prévue, et aucune adoption par vote populaire n’est envisagée : seulement des auditions publiques en commission parlementaire avant que le projet suive le cours d’une loi régulière pour son adoption.
Il nous apparait qu’un tel processus porte atteinte à la légitimité même du projet. Cela risque d’entrainer des répercussions importantes sur son appropriation future par la population et les différents groupes de la société.
1.1 La participation de la population et l’appropriation constitutionnelle
Tant aux Nations Unies que dans les études sur le sujet, la participation libre et démocratique de la population et de l’ensemble des groupes de la société aux réformes constitutionnelles est considérée comme une condition essentielle à tout projet constitutionnel. En effet, l’adhésion à une constitution, sa légitimité et, conséquemment, son applicabilité future dépendent largement de la manière dont le projet est conçu et adopté : moins le processus est participatif, ouvert et transparent, plus la légitimité des normes suprêmes tend à être remise en question.
La réussite d’une réforme constitutionnelle dépend en grande partie de l’appui des différents segments de la société. De nombreux exemples montrent que les réformes constitutionnelles gagnent à être réalisées avec la participation du public et ne devraient pas être laissées aux seuls politiciens, dans la mesure où l’appropriation partagée de la réforme représente en soi un atout majeur. Cela étant, la contribution unique que les différents acteurs sociaux peuvent apporter est tout aussi importante[2].
En d’autres termes, la forme est aussi importante que le fond : une mise au monde précipitée et bâclée peut ainsi générer un manque de légitimité qui devient, en quelque sorte, une tare originelle affectant le respect et l’applicabilité de la loi suprême. Nous en avons un exemple frappant ici même : le rapatriement de la Constitution au Canada, avec l’adoption de la Loi constitutionnelle de 1982, s’est effectué de manière précipitée, peu transparente et sans le consentement de certaines provinces, dont le Québec. L’histoire le démontre depuis : politiquement et socialement, notre adhésion à la Constitution canadienne est périodiquement remise en question et elle l’est encore aujourd’hui.
1.2 Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et le droit de prendre part à la conduite des affaires publiques
En regard des normes internationales, le respect du droit à l’autodétermination des peuples implique leur participation active aux réformes constitutionnelles, tant pour l’élaboration et l’adoption d’une nouvelle constitution que pour sa révision et sa modification ultérieure[3]. De même, comme l’a précisé le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, le droit de prendre part à la conduite des affaires publiques englobe aussi les processus constitutionnels. Le respect des exigences liées à ce droit suppose donc la représentation et la participation de grands secteurs de la société sur ce plan[4]. Ainsi, la domination du processus par une petite élite politique ou par un seul parti peut constituer une violation de ces droits.
1.3 Assurer la participation de la population dans l’élaboration et l’adoption d’une constitution
En matière d’élaboration : un projet de constitution ne saurait donc être confié qu’à un petit groupe d’expertes et d’experts et de responsables politiques, mais plutôt organisé :
(…) de manière à permettre la participation sans entraves des différents segments de la société et la véritable prise en considération de leurs propositions. À cette fin, il est nécessaire de mettre en place non seulement des moyens de communication, mais aussi d’autres capacités organisationnelles. Il est par ailleurs essentiel que l’étape de la rédaction offre la possibilité de débattre librement et entièrement les options constitutionnelles proposées par les différents segments de la société. Enfin, il est important que l’ensemble des administrés aient le droit de participer au débat et d’émettre des propositions, et qu’ils soient encouragés et habilités à le faire[5].
Mettre en place une assemblée constituante composée de représentantes et représentants élus issus de tous les secteurs de la société est généralement le moyen préconisé pour assurer la plus large participation possible à l’élaboration du projet, tout en demeurant réalisable. Le rôle de l’assemblée peut porter tant sur la définition de la forme — c’est-à-dire le processus détaillé qui mènera à l’élaboration et à l’adoption de la constitution — que sur celle du fond, à savoir la rédaction du projet lui-même.
Veiller à la plus large représentation possible
L’appropriation nationale suppose la participation, entre autres, des acteurs officiels, des partis politiques, de la société civile et du grand public. De plus, les défenseurs des droits de l’homme, les associations de juristes, les médias et autres organisations de la société civile, y compris celles qui représentent les femmes, les enfants, les minorités, les peuples autochtones, les réfugiés, les apatrides, les personnes déplacées, les travailleurs et les entrepreneurs, devraient pouvoir se prononcer dans le cadre d’un processus d’élaboration de la Constitution ouvert et participatif.
Note d’orientation du Secrétaire général sur l’assistance des Nations Unies à l’élaboration de constitutions (avril 2009), p. 4.
En matière d’adoption : il est admis que tout processus d’adoption, de révision et de modification d’une constitution devrait être soumis à la population par référendum.
À la CSQ, nous estimons que ni la manière dont le gouvernement a rédigé le projet de constitution ni le processus de consultation proposé, précipité et limité aux groupes pouvant se présenter en commission parlementaire, ne respectent les droits fondamentaux ni constituent une base solide pour assurer la légitimité du texte en tant que loi suprême, ainsi que son appropriation par la population et l’ensemble des groupes de la société.
Cela apparait d’autant plus illégitime lorsque l’on constate l’absence de participation réelle des peuples autochtones à la construction du projet.
1.4 L’autodétermination des peuples autochtones, un principe incontournable pour une constitution légitime
Le projet de constitution ne peut prétendre à aucune légitimité sans le plein respect des droits collectifs des peuples autochtones, présents ici depuis des millénaires. Il est impératif de reconnaitre que le droit à l’autodétermination des Premières Nations et des Inuit est fondamental, et soutenu par le droit international et la jurisprudence canadienne. Ce droit ne doit pas rester symbolique et implique que les peuples autochtones puissent choisir leur avenir politique, social et culturel, et participer pleinement à toute réforme constitutionnelle.
La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA)[6], adoptée en 2007, exige que les États obtiennent le consentement libre, éclairé et préalable des peuples autochtones avant toute décision qui les concerne, comme le précisent ses articles 18 et 19. De plus, l’article 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques[7] affirme le droit des peuples à décider eux-mêmes de leur avenir. Ces textes ne sont pas de simples recommandations : ils engagent le Québec à respecter ces principes afin de préserver sa légitimité et sa réputation sur la scène internationale.
Le devoir de consulter, reconnu par la Cour suprême dans l’arrêt Nation haïda c. Colombie-Britannique (2004)[8], s’applique d’autant plus à une réforme constitutionnelle qu’elle touche directement les droits ancestraux et issus de traités protégés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982[9]. Ne pas respecter cette obligation reviendrait à reproduire des pratiques coloniales que le Québec prétend vouloir dépasser.
La Constitution est la base de la gouvernance et incarne les valeurs qui guideront l’action publique. Si elle est rédigée sans la participation active des peuples autochtones, elle souffrira d’un déficit démocratique majeur. L’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) a d’ailleurs dénoncé l’absence de véritables consultations en amont du projet de loi. Les rencontres ponctuelles, conduites de façon très limitée avec certaines nations seulement, sont loin d’être suffisantes : il faut un vrai dialogue structuré et continu avec l’ensemble des communautés autochtones du Québec.
Une démarche non inclusive expose le gouvernement québécois à des contestations juridiques, à des ruptures sociales et à une perte de confiance envers les institutions. À l’inverse, une approche collaborative, fondée sur le respect et la reconnaissance mutuels, peut devenir un puissant levier de réconciliation. Selon la Ligue des droits et libertés, cette voie permettrait de bâtir une constitution qui reflète la diversité et la richesse des identités du territoire, plutôt que de perpétuer un modèle centralisateur.
Les Premières Nations et les Inuit ont façonné l’histoire et le développement du Québec. Leur vision, leurs savoirs et leurs langues constituent un patrimoine vivant qui enrichit notre société. Les ignorer, c’est nier une part essentielle de notre identité collective.
Reconnaitre l’autodétermination, c’est aussi lutter contre les inégalités. Le rapport de la commission Viens et les appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada ont révélé l’ampleur des discriminations subies par les Autochtones dans les services publics. Une constitution qui ne tient pas compte de ces réalités risque de renforcer ces injustices au lieu de les corriger.
Le projet de loi est donc une occasion unique de refonder notre cadre constitutionnel sur des bases démocratiques et inclusives. Cette ambition ne pourra se concrétiser sans la reconnaissance pleine et entière des droits des peuples autochtones, ainsi que leur participation active à chaque étape du processus. Pour la CSQ, il s’agit d’une question de justice, de respect et de cohésion sociale. Une constitution élaborée sans la participation des peuples autochtones serait incomplète, incapable de refléter la pluralité du Québec et de porter les valeurs de réconciliation que nous proclamons.
2. Un projet qui met à mal l’État de droit
2.1 L’État de droit et l’État arbitraire
Ce qui distingue une société démocratique d’un régime autoritaire, au-delà des élections et de la présence d’une assemblée élue par le peuple, c’est le respect de l’État de droit. Celui-ci désigne un mode d’organisation de la société où les pouvoirs de l’État sont soumis à la règle de droit et à des normes supérieures assurant : 1) l’équilibre, la séparation et l’organisation des pouvoirs (législatif, exécutif et judiciaire); 2) l’égalité devant la loi et la protection des droits et des libertés fondamentales. L’exercice de tout pouvoir (incluant le pouvoir de coercition) n’est donc pas soumis, ultimement, à la volonté des détenteurs du pouvoir (même s’il s’agit d’une assemblée élue), mais bien à la primauté du droit, selon un système de normes hiérarchisées.
La hiérarchie des normes suppose que chaque norme de rang inférieur doit être conforme à celle qui lui est supérieure. Les normes supérieures, c’est-à-dire la loi suprême, sont codifiées dans ce que l’on appelle la Constitution. C’est donc dire son importance centrale dans la structure et le fonctionnement de notre société en tant que démocratie.
L’État arbitraire, pour sa part, considère que le dernier mot revient ultimement à la volonté des détenteurs du pouvoir, que ce soit une assemblée élue, une oligarchie ou une seule personne. Sa mise en œuvre passe par le diktat : l’autorité édicte et met en œuvre la norme sans être encadrée par des principes supérieurs. L’exercice de la coercition dépend donc des volontés de l’autorité.
Actuellement, il existe de nombreuses démocraties incomplètes et des régimes hybrides dans le monde où l’autorité publique est exercée par des représentantes et représentants élus par la population, mais où la primauté du droit n’est pas garantie et où les contre-pouvoirs sont affaiblis par l’arbitraire, voire complètement neutralisés. La démocratie basée sur l’État de droit a beaucoup reculé dans le monde depuis 10 ans, et la majorité de la population mondiale vit désormais dans un régime arbitraire et autoritaire[10].
Au sud de notre frontière, le président actuel s’attaque directement à l’État de droit, en construisant les bases d’un régime arbitraire par des décisions et des actions remettant volontairement en question la séparation des pouvoirs et l’action des contre-pouvoirs, dont le judiciaire; en édictant ses volontés par des décrets faisant fi du droit et en ayant recours à la coercition de façon à favoriser l’arbitraire.
Un tel contexte appelle les élues et élus québécois à faire preuve du plus haut degré de diligence et de vigilance pour tout ce qui concerne la démocratie québécoise et la protection des droits et des libertés fondamentales. Or, plusieurs lois adoptées récemment ont retiré la protection offerte par les chartes des droits et des libertés en recourant aux clauses de dérogation. En agissant ainsi, de façon préemptive, le gouvernement tente d’empêcher le contrôle de ses actions et de permettre aux tribunaux de déterminer si son action est compatible avec les normes constitutionnelles. Rappelons-le : au Québec, il demeure possible de porter atteinte à un droit garanti constitutionnellement si on le fait d’une manière qui peut se justifier dans une société libre et démocratique.
Dans un État de droit, aucun des trois pouvoirs n’a en principe de primauté sur l’autre. Le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, souvent confondus dans le parlementarisme inspiré de la tradition britannique, ne sont pas au-dessus du pouvoir judiciaire. Les trois pouvoirs se contrebalancent, et les acteurs de la société, qu’il s’agisse d’individus ou d’organisations, peuvent exercer des contre-pouvoirs démocratiques : pétitions, manifestations pacifiques et recours judiciaires. Ce rôle de contre-pouvoir dévolu aux organisations de la société civile est largement reconnu comme une condition sine qua non à toute démocratie en bonne santé[11]. En effet, l’État de droit s’est construit avec des traditions et des institutions, comme le débat public, la négociation et le recours aux tribunaux, afin d’éviter que le rapport de force s’exerce de manière violente.
Malheureusement, le projet de constitution qui nous est présenté, loin de renforcer les bases de notre démocratie, remet dangereusement en question l’État de droit au profit de l’arbitraire du pouvoir politique, notamment en consacrant, dans l’absolu, un principe de souveraineté parlementaire. Cela est d’autant plus préoccupant qu’au Québec, le contrôle exercé par le pouvoir exécutif sur le pouvoir législatif est déjà excessif en contexte de majorité parlementaire, si bien que l’on ne peut parler d’une véritable séparation des pouvoirs.
2.2 Souveraineté parlementaire ou monarchisme absolu?
Le projet de loi constitutionnelle fait plusieurs références au concept de « souveraineté du parlement » et de « souveraineté parlementaire ». Ce principe se résume ainsi selon la professeure Johanne Poirier : « Dans un régime parlementaire représentatif, la souveraineté parlementaire vise à donner — sauf exceptions constitutionnalisées — le dernier mot au peuple, par l’entremise de ses représentants démocratiquement élus[12]. » (c’est nous qui soulignons)
La souveraineté parlementaire confère à la législature le pouvoir d’adopter les lois qu’elle souhaite, de les modifier ou de les abroger en toute liberté, sous réserve du respect de l’ordre constitutionnel existant. Or, la souveraineté parlementaire, dans notre société démocratique, se distingue de la monarchie absolue et des régimes dictatoriaux. Dans ces sociétés, le monarque ou le dictateur détient une souveraineté sans limites : il impose les règles à sa guise et n’a pas à se justifier. Très souvent, il existe une constitution de façade dans ces régimes dictatoriaux et, si cette constitution entrave un tant soit peu la volonté du dictateur, celui-ci la modifie ou la suspend unilatéralement. L’histoire moderne ne manque pas de cas d’espèce où des dictateurs qui étaient limités constitutionnellement par le nombre de mandats qu’ils pouvaient exercer ont suspendu les règles dans l’objectif de se maintenir au pouvoir.
La souveraineté parlementaire au Québec est un principe qui doit demeurer. Elle permet ainsi à la législature de réagir à certaines décisions judiciaires qui, par exemple, jugeraient une règle de droit comme étant inconstitutionnelle. Le pouvoir judiciaire reconnait ce principe qui conduit à une certaine retenue afin de permettre à la législature d’exercer sa souveraineté. Prenons un cas récent : dans Centre for Gender Advocacy c. Attorney General of Quebec[13], le juge de première instance, l’honorable Gregory Moore, en était venu à la conclusion que certaines dispositions du Code civil du Québec portaient atteinte aux droits fondamentaux des personnes non binaires, transgenres ou intersexes protégées par la Charte canadienne des droits et libertés et la Charte des droits et libertés de la personne. Ces dispositions ne respectant pas l’ordre constitutionnel, le juge les a invalidées. Toutefois, afin de respecter le principe de souveraineté parlementaire, il a suspendu sa décision pendant plusieurs mois. Cette suspension, qui peut être prolongée, permet à la législature de décider comment elle entend modifier les lois afin de se conformer à l’ordre constitutionnel. Et c’est ainsi que l’Assemblée nationale a adopté, dans les mois subséquents, le projet de loi no 2[14] afin de modifier le Code civil.
Un autre exemple récent concerne le débat sur le droit à l’aide médicale à mourir dans la dignité pour certaines personnes atteintes de graves maladies, mais dont la mort n’est pas prévisible à court terme. Dans ce cas, le gouvernement fédéral a demandé au tribunal quatre prolongations[15] afin de suspendre l’effet du jugement et de permettre au Parlement du Canada de se conformer à sa décision sur l’aide médicale à mourir.
On voit par ces exemples que la souveraineté parlementaire est un principe qui permet au pouvoir exécutif et au pouvoir législatif de réagir à une décision du pouvoir judiciaire, afin de se conformer à la Constitution. Toutefois, il faut faire attention de ne pas confondre le principe de souveraineté parlementaire avec celui de l’absolutisme. Or, il y a lieu de s’inquiéter à la lecture de l’article 9 de la Loi sur l’autonomie constitutionnelle du Québec, incluse dans le projet de loi no 1 :
- Le Parlement du Québec peut, lorsqu’il le juge opportun, inclure une disposition de souveraineté parlementaire, d’office ou en réponse à une décision judiciaire, dans toute loi qu’il édicte, sans qu’il soit requis de la contextualiser ou de la justifier.
Il ne peut être exercé aucun pourvoi en contrôle judiciaire, fondé sur un droit ou une liberté visés par une telle disposition de souveraineté parlementaire, en vue de faire déclarer inopérante la loi ou la disposition visée par cette disposition de souveraineté parlementaire.
Par ailleurs, l’article 5 de la Loi sur l’autonomie constitutionnelle du Québec tente aussi de limiter la possibilité de contester juridiquement les actions gouvernementales. Le deuxième alinéa cherche à interdire à un organisme d’utiliser des sommes provenant du fonds consolidé du revenu ou d’autres sommes provenant d’impôts, de taxes, de droits ou de sanctions prélevés en application d’une loi du Québec, afin de contester devant les tribunaux une loi que le gouvernement a soustraite à la Constitution.
Le gouvernement cherche ainsi à mettre au pas l’ensemble des organismes de l’État qui pourraient légitimement et démocratiquement contester ces décisions. Ces organismes sont prévus à l’annexe I et sont, notamment : le Protecteur du citoyen, les centres de services scolaires, les cégeps, les universités et même les ordres professionnels. De plus, le gouvernement se donne la possibilité d’élargir la notion « d’organismes », ce qui peut raisonnablement susciter des questionnements quant à l’inclusion d’autres acteurs sociaux.
Ces dispositions soulèvent de grandes inquiétudes. Premièrement, comment, dans une société libre et démocratique, peut-on permettre au pouvoir exécutif qui, bien souvent, commande le pouvoir législatif, de s’abstenir de contextualiser ou de justifier une violation aux droits fondamentaux? Le principe de la souveraineté parlementaire repose sur l’idée que le peuple, par l’intermédiaire de ses élues et élus, a le dernier mot, dans le respect de la Constitution. Ici, il apparait que l’on consacre le principe selon lequel le gouvernement et la législature ne sont pas redevables devant le peuple.
Deuxièmement, comment, dans une société libre et démocratique, peut-on prétendre que la Constitution est la loi des lois, tout en permettant à un gouvernement d’y déroger dès qu’un tribunal constate qu’il y contrevient? Les règles de la Constitution sont-elles optionnelles dès qu’elles ne font pas l’affaire du gouvernement en place?
Troisièmement, comment, dans une société libre et démocratique, peut-on justifier le fait de retirer le droit aux citoyennes et citoyens de faire contrôler en justice les décisions gouvernementales? Cela peut sembler logique dans un régime dictatorial, mais se justifie difficilement dans le contexte actuel.
Par exemple, qu’est-ce qui empêcherait un futur gouvernement d’interdire ou de limiter le droit à l’avortement en invoquant cette disposition? Il lui suffirait d’adopter une loi attentatoire au droit à l’avortement et d’office de la soustraire à la Constitution afin d’empêcher quiconque de la contester.
Ces préoccupations sont partagées par de nombreux experts et expertes, ainsi que par diverses organisations. Comme le souligne le Barreau du Québec dans une sortie récente et historiquement inusitée et faisant référence aux projets de loi nos 1, 2 et 3 : « Le Barreau déplore que plusieurs projets de loi récemment présentés à l’Assemblée nationale du Québec incluent des dispositions qui entravent significativement la capacité des citoyens et des citoyennes à faire valoir leurs droits et leurs opinions[16]. »
Les articles 5 et 9 tels que proposés dans le projet de loi constitutionnelle sont injustifiés : ils sont incompatibles avec les principes élémentaires de la démocratie et de l’État de droit. En effet, puisque le droit de recourir aux tribunaux est un droit fondamental, il est impératif que la Constitution protège ce droit. Ultimement, si un tribunal de dernier recours juge qu’une loi est invalide parce qu’elle ne respecte pas la Constitution, le principe de la souveraineté parlementaire qui doit s’appliquer et qui permet à la législature d’avoir le dernier mot est celui du recours à un amendement constitutionnel, selon des mécanismes prévus et conformes aux principes démocratiques.
2.3 Le danger de la hiérarchisation des droits
L’article 9.1 de la Charte des droits et libertés de la personne énonce les différents principes à respecter en matière de droits et de libertés de la personne. Le projet de loi actuel vise, notamment, à ajouter à cet article le principe d’égalité entre les femmes et les hommes, de sorte que tout droit et toute liberté devront s’exercer dans le respect de ce principe.
L’article 21 du projet de loi prévoit l’ajout de l’article 9.2 qui précise que l’exercice du droit à l’égalité entre les femmes et les hommes doit primer sur la liberté de religion. La proposition a pour effet de créer une hiérarchisation d’un droit sur un autre.
La Cour suprême s’est déjà penchée sur les problèmes que la hiérarchisation d’un droit sur un autre peut provoquer :
Il faut se garder d’adopter une conception hiérarchique qui donne préséance à certains droits au détriment d’autres droits, tant dans l’interprétation de la Charte que dans l’élaboration de la common law. Lorsque les droits de deux individus sont en conflit […], les principes de la Charte commandent un équilibre qui respecte pleinement l’importance des deux catégories de droits[17].
C’est donc le principe de la conciliation contextuelle des droits qui prévaut au sein de la jurisprudence, principe qui a l’avantage de tenir compte du contexte spécifique pour chacun des cas d’espèce qui sont soumis et du fait qu’aucun droit n’est absolu.
L’article 21 du projet de loi, qui instaurerait cette hiérarchisation entre le droit à l’égalité entre les femmes et les hommes et la liberté de religion dans la Charte des droits et libertés de la personne, n’est donc pas justifié. Il a aussi pour effet de complexifier l’interprétation du droit à l’égalité prévu par la Charte. Faut-il en conclure que le droit à l’égalité entre les femmes et les hommes prévaut uniquement par rapport à la liberté de religion? Qu’en est-il par rapport aux autres droits prévus à la Charte?
3. Les droits et les libertés à protéger dans la Constitution
3.1 Protéger la liberté d’association
Parmi les droits et les libertés qui sont actuellement protégés par la Charte des droits et libertés de la personne, la liberté d’association constitue, pour la CSQ, ses fédérations et ses syndicats affiliés, le droit fondamental qui leur permet de réaliser leur mission : promouvoir et défendre les intérêts économiques, professionnels et sociaux de leurs membres, dans le respect des valeurs fondamentales d’égalité, de solidarité, de justice sociale, de liberté, de démocratie et de coopération.
Cette liberté permet aux travailleuses et travailleurs de s’unir, de s’organiser, de revendiquer de meilleures conditions de travail ainsi que d’exercer un rapport de force juste et équitable dans la négociation de ces conditions de travail. Dans l’exercice de ce rapport de force, cette liberté leur permet d’exercer le droit de grève.
La liberté d’association permet aussi aux travailleuses et travailleurs de militer et de promouvoir la défense des autres droits et libertés qui sont prévus par la Charte, comme le droit à l’égalité, à l’équité salariale, à un environnement de travail sécuritaire, à un environnement sain, etc.
Les partis politiques, les organismes communautaires, les syndicats, les associations d’employeurs, les diverses coalitions, les nombreux mouvements sociaux et l’ensemble des groupes d’intérêts existent et s’expriment parce que cette liberté leur est reconnue. Tous ne s’entendent pas sur les décisions à prendre pour faire avancer la société, mais chacun contribue à un débat public civilisé et pacifique.
La protection de cette liberté figure dans le projet de loi actuel et, ultimement, elle doit être inscrite dans la future constitution québécoise.
3.2 Constitutionnaliser formellement les droits économiques et sociaux
Le projet de loi constitutionnelle propose à son article 16 d’intégrer les articles 1 à 38 de la Charte des droits et libertés de la personne dans la future constitution. Ces articles possèdent déjà le statut de dispositions quasi constitutionnelles, puisqu’ils s’appliquent par préséance à toute autre disposition, comme l’indique l’article 52 de la Charte. Cette intégration à la Constitution apparait donc naturelle et logique.
Il y a donc lieu de constater que le chapitre IV de la Charte, soit les articles 39 à 48, qui énoncent les droits économiques et sociaux, ne sera pas constitutionnalisé. Ces droits énoncent des principes importants pour la société québécoise, notamment :
- un droit à la protection et à la sécurité de certaines personnes (articles 39 et 48);
- le droit à l’instruction publique gratuite (article 40);
- le droit à l’information (article 44);
- le droit à des mesures d’assistance financière et à des mesures sociales susceptibles de lui assurer un niveau de vie décent (article 45);
- le droit à des conditions de travail justes et raisonnables qui respectent la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleuses et travailleurs (article 46);
- le droit de vivre dans un environnement sain et respectueux de la biodiversité (article 46.1).
À l’heure actuelle, ces droits, contrairement aux articles 1 à 38 de la Charte, ne bénéficient pas de la préséance que confère l’article 52. Entamer l’écriture de la Constitution québécoise nous apparait être le moment idéal pour y consacrer formellement leur importance et permettre aux citoyennes et citoyens de revendiquer pleinement chacun de ces droits.
Afin d’alimenter cette réflexion, nous nous permettons de reprendre les propos que Me Pierre Bosset, avocat à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ), a formulé en 1996 :
Ni la lettre des dispositions en cause ni l’invocation rituelle et quasi incantatoire d’une différence de nature entre eux et d’autres droits ne justifient, cependant, l’indifférence dans laquelle on continue à considérer les droits économiques et sociaux. De notre analyse ressort, plutôt, l’image d’une juridicité réelle, encore peu explorée. Après vingt années d’application de la Charte, le temps nous semble venu d’une réhabilitation des droits économiques et sociaux dans le discours juridique. Composante essentielle du corpus des droits de la personne, les droits économiques et sociaux ne doivent plus être considérés comme les parents pauvres d’une charte dont ils contribuent à définir la spécificité[18].
3.3 Éviter une atteinte au droit des femmes
Nous souhaitons souligner la volonté du gouvernement de protéger la liberté des femmes de choisir en matière d’interruption volontaire de grossesse, une volonté que nous partageons depuis de nombreuses années à la CSQ. Cependant, il importe de rappeler au législateur un vieil adage : le mieux est l’ennemi du bien, ce qui signifie qu’en voulant trop bien faire, on risque de compromettre ce qui est aujourd’hui satisfaisant. Il nous semble que l’article 29 du projet de loi, qui stipule que l’État protège la liberté des femmes d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse, constitue un exemple de ce « mieux ».
Un peu d’histoire
Depuis de nombreuses années, les féministes québécoises ont fait du droit à l’avortement une priorité. L’audace, la ténacité et le courage dont a fait preuve le mouvement féministe ont permis au Québec de devenir une province où les personnes enceintes ont accès à une véritable liberté de choix en matière d’avortement. Cette liberté, nous la devons également à deux décisions importantes qui font jurisprudence en la matière.
En 1988, la Cour suprême reconnaissait que l’article encadrant l’avortement dans le Code criminel contrevenait à l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. Le gouvernement canadien s’est vu obligé d’agir et a décidé de retirer l’article, menant à une décriminalisation complète de l’avortement. La plupart des pays dans le monde ont emprunté une voie bien différente de celle du Canada. Plutôt que de décriminaliser, ces pays ont préféré légaliser l’avortement, c’est-à-dire de l’autoriser sous certaines conditions. Si ces dernières ne sont pas respectées, une criminalisation de l’avortement s’ensuit.
À cette décriminalisation s’ajoute la décision de la Cour suprême dans l’affaire Tremblay c. Daigle[19], qui reconnait que les droits constitutionnels ne s’appliquent qu’au moment de la naissance vivante, faisant en sorte qu’aucun de ces droits ne peut s’appliquer au fœtus.
Il importe également de rappeler qu’avant cette jurisprudence et cette décriminalisation de l’avortement, le Québec avait fait le choix d’adopter une certaine posture de tolérance. Effectivement, alors que le Code criminel rendait illégal tout avortement pratiqué hors d’un milieu hospitalier et sans l’approbation d’un comité d’avortement thérapeutique, le Québec remboursait, par l’entremise de la Régie de l’assurance maladie du Québec, des avortements qui étaient réalisés à l’extérieur des établissements hospitaliers. Il en est même venu à refuser de poursuivre les médecins qui pratiquaient ces interventions dites illégales, sous prétexte que les tribunaux ne condamnaient pas les avorteurs[20].
Un article qui n’est pas neutre
En 2025, nous savons que recourir au mot femme n’est pas neutre. C’est pourtant le terme qui est utilisé pour cet article, terme pouvant mener à une atteinte à cette liberté de choix pour certaines des personnes nécessitant une interruption volontaire de grossesse. Par ce choix de mot, l’État serait tenu de protéger la liberté des femmes, ce qui pourrait mener à des pertes de droits pour les personnes non binaires et trans qui, actuellement, détiennent une liberté de choisir. Voilà, selon nous, la démonstration de ce que les groupes féministes répètent depuis longtemps : toute loi sur l’avortement est une loi antiavortement.
Un article constitutionnel protège-t-il réellement le droit à l’avortement?
Il y a un peu plus d’un an, la France faisait le choix d’inscrire à sa constitution un article visant à protéger la liberté de choisir des femmes en matière d’interruption volontaire de grossesse. Contrairement à ce que nous propose le législateur au Québec, le libellé de la Constitution française prévoit qu’une loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce cette liberté de choix. Cette loi, chez eux, permet l’interruption volontaire de grossesse jusqu’à 14 semaines.
Peu avant la France, le Chili a également entrepris un projet de révision de sa constitution, lequel prévoyait un libellé visant à protéger le droit à l’avortement des femmes. Cette proposition a soulevé parmi la population de grandes inquiétudes, puisqu’aucune limite de temps n’y était prévue. La réponse d’une participante au projet d’élaboration de la Constitution a été la suivante : « Le délai n’est pas mentionné, car ce n’est pas une donnée constitutionnelle. C’est la loi qui doit préciser dans quels délais il est possible d’exercer ce droit[21]. »
Bien que la Constitution chilienne n’ait pas passé le cap de l’adoption, cet exemple demeure pour nous pertinent dans l’évaluation de la protection que peut avoir un article dans un projet de loi constitutionnelle. Cette inscription n’a aucunement protégé les pays cités plus haut de la mise en place d’une loi visant à encadrer ou à limiter l’accès à l’avortement. Au contraire, la loi déjà en vigueur en France a été maintenue et prévue à même la Constitution, et le Chili prévoyait l’encadrement de ce droit par le biais d’une loi.
Depuis 1988, c’est environ 50 motions ou projets de lois visant à interdire ou à restreindre le droit à l’avortement qui ont été déposés à la Chambre des communes. L’article 29 ne pourrait empêcher le dépôt ni l’adoption d’une loi qui viserait à encadrer et à restreindre l’accès à l’avortement. Au contraire, l’adoption de cet article pourrait entrainer un débat sur la place publique susceptible de nuire à cette liberté de choisir que l’on tente ici de protéger.
Répondre à la véritable demande de la société québécoise
En octobre dernier étaient publiées les données d’un sondage affirmant que 77 % de la population québécoise se disait favorable à ce que le Québec se dote d’outils légaux supplémentaires pour protéger le droit à l’avortement[22]. Réjouissons-nous de ces résultats qui démontrent que nous sommes nombreuses et nombreux, au Québec, à vouloir protéger ce droit durement acquis. Il convient toutefois de se demander si l’article 29 répond réellement au besoin exprimé.
Lorsque l’idée de légiférer s’était pointée dans l’espace public, les groupes spécialisés en matière d’avortement n’ont pas tardé à se faire entendre. Les groupes féministes, le Barreau et les médecins ont affirmé haut et fort que ce n’était pas la voie à emprunter. La meilleure façon de protéger nos acquis demeurait de ne pas légiférer. Nous l’avons déjà mentionné, mais nous nous permettons de le répéter : toute loi sur l’avortement est, en réalité, une loi antiavortement.
En 2023, la Fédération du Québec pour le planning des naissances (FQPN) avait également mis en garde le gouvernement contre les dérives possibles d’une législation.
En voulant légiférer, le gouvernement du Québec s’apprête à engendrer un débat pour lequel il n’est pas prêt. Il sous-estime les stratégies discursives de désinformation, d’appel aux émotions et d’ambiguïté, largement documentées, qu’emprunte le mouvement contre l’avortement nord-américain, et qui pourraient réussir au Québec[23].
Nous partageons cette mise en garde de la FQPN. Si le législateur souhaite réellement répondre à la volonté de la population québécoise de protéger le droit à l’avortement, le retrait de l’article 29 du projet de loi constitutionnelle demeure la meilleure façon d’y parvenir.
L’histoire nous le démontre : le Québec a eu la possibilité de défendre ce droit sans mention dans une constitution. Il demeure que, même si cet article venait à être adopté, rien n’empêcherait un futur parti politique de déposer un projet de loi visant à restreindre l’accès à l’avortement. Dans l’exercice de la balance des inconvénients, nous sommes d’avis que les inconvénients surpassent les avantages que l’on peine à voir. Nous demandons au législateur de poursuivre les efforts quant à l’accessibilité des services et de retirer l’article 29 du projet de loi.
3.4 Le droit à l’environnement : un droit fondamental à affranchir du carcan politique
Il est somme toute étonnant que le projet de constitution ne fasse aucune place à la question environnementale alors que les changements climatiques, et plus largement la crise écologique, menacent à terme la survie de l’espèce humaine, au Québec comme ailleurs. Le gouvernement pourra répondre que ce droit est déjà prévu par la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, laquelle sera intégrée à la Constitution. Or, l’article 46.1 énonce ce qui suit : « Toute personne a droit, dans la mesure et suivant les normes prévues par la loi, de vivre dans un environnement sain et respectueux de la biodiversité. »
En apparence, cette formulation consacre un droit à l’environnement; en réalité, elle le subordonne entièrement à la volonté politique du législateur. L’expression « dans la mesure et suivant les normes prévues par la loi » retire à ce droit toute portée autonome : il ne crée aucune obligation directe pour l’État ni pour les acteurs économiques, et il ne confère aucun recours effectif aux citoyennes et citoyens. Ce droit, ainsi conditionné, n’est pas un véritable droit fondamental. Il devient un simple énoncé de principe, tributaire du contexte politique et des priorités gouvernementales du moment.
Cette subordination juridique est d’autant plus problématique qu’elle prive le droit à l’environnement de sa substance démocratique : ce ne sont plus les tribunaux ni la société civile qui peuvent invoquer ce droit pour protéger le bien commun, mais uniquement le législateur qui décide du cadre, de la portée et des limites de ce qu’il reconnait comme « environnement sain ». En d’autres mots, la Charte ne garantit pas ce droit : elle autorise le pouvoir politique à en disposer. C’est une inversion du principe même des droits fondamentaux, qui devraient être des garde-fous contre les dérives du pouvoir, non des privilèges que le gouvernement octroie à sa convenance.
Dans le contexte où le pouvoir et la portée du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) ont été considérablement affaiblis, sur quoi la population et les organisations de la société civile peuvent-elles s’appuyer pour revendiquer le respect du droit à un environnement sain, condition sine qua non à l’exercice de tous les autres droits prévus par la Charte?
De nombreux pays ont intégré dans leur constitution le droit à un environnement sain en tant que droit fondamental, indépendant du pouvoir législatif, ce qui favorise une véritable participation publique pour le faire valoir. En voici quelques exemples, desquels le Québec devrait s’inspirer :
- En France, la Charte de l’environnement de 2004 est intégrée au bloc de constitutionnalité et reconnait que « chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ». Elle institue notamment les principes de précaution, de prévention et du pollueur-payeur.
- L’article 112 de la Constitution norvégienne reconnait à chaque personne le droit de vivre dans un environnement propice à la santé et dans un milieu naturel dont la productivité et la diversité sont préservées. L’article stipule également que les ressources naturelles doivent être gérées selon des considérations à long terme, de manière à garantir ces mêmes droits aux générations futures. Cet article impose à l’État norvégien une obligation positive d’action pour mettre en œuvre ces principes. L’article 112 confère de véritables droits individuels justiciables : les citoyennes et citoyens et les associations peuvent donc l’invoquer devant les tribunaux pour contester toute mesure ou politique contraire à la protection environnementale.
- L’article 66 de la Constitution portugaise consacre le droit de toute personne à un environnement de vie sain et écologiquement équilibré, ainsi que le devoir de le défendre. Il impose à l’État d’assurer la protection de la nature, la rationalisation de l’exploitation des ressources naturelles et la planification du territoire dans une perspective de développement durable. Cet article a une portée contraignante : il fonde directement les politiques publiques environnementales et peut être invoqué dans le cadre de recours citoyens ou collectifs visant à faire respecter ces principes.
- La Constitution équatorienne de 2008 est la première au monde à reconnaitre la Nature — la Pachamama — comme sujet de droit. Elle affirme que la Nature a droit au respect intégral de son existence, ainsi qu’à la préservation et à la régénération de ses cycles vitaux. L’État a le devoir d’appliquer des mesures de précaution et de restauration en cas d’atteinte aux écosystèmes. Ces droits peuvent être invoqués directement devant les tribunaux, comme en témoignent des décisions emblématiques, dont celle relative à la rivière Vilcabamba (2011), qui ont confirmé que les écosystèmes disposent d’une personnalité juridique et peuvent être défendus par des citoyennes et citoyens ou par des organisations au nom de la nature elle-même.
- La Constitution bolivienne de 2009 reconnait à toute personne le droit à un environnement sain, protégé et équilibré, au bénéfice des générations présentes et futures ainsi que des autres êtres vivants. La Loi des droits de la Terre-Mère (2010), qui en découle, affirme que la Terre constitue un système vivant dynamique et doté de droits collectifs fondamentaux, dont le droit à la vie, à la diversité, à l’eau et à la régénération. L’État est tenu d’élaborer des politiques publiques pour préserver ces droits et peut être poursuivi pour manquement à ses obligations envers la Terre-Mère.
La participation des peuples autochtones a été centrale et déterminante dans la genèse des dispositions environnementales des constitutions de l’Équateur (2008) et de la Bolivie (2009). Ces deux processus constituent des précédents majeurs en matière de constitutionnalisation du pluralisme écologique et juridique. Le Québec peut et doit s’inspirer de ces modèles, lesquels constituent une raison de plus d’accorder une place de choix aux dix Nations autochtones et au peuple inuit dans l’élaboration de sa constitution.
Si le projet de loi no 1 veut réellement donner à la Constitution québécoise une portée émancipatrice, il faut minimalement retirer la clause limitative « dans la mesure et suivant les normes prévues par la loi » de l’article 46.1 de la Charte et reconnaitre le droit à un environnement sain comme un droit plein, direct et justiciable. Ce droit doit créer des obligations positives pour l’État : prévenir les atteintes graves à la biodiversité et au climat, rendre des comptes sur ses politiques environnementales, et permettre aux citoyennes et citoyens, aux syndicats et aux communautés locales de recourir aux tribunaux pour faire respecter ce droit.
Pour la CSQ, le droit à l’environnement n’est pas un luxe moral : c’est une condition essentielle à l’exercice de tous les autres droits prévus par la Charte, sans laquelle la santé publique, la justice sociale et le travail décent sont impossibles. Tant qu’il demeurera balisé par des clauses d’exception politiques, ce droit restera lettre morte. Il faut lui redonner sa véritable nature : un droit fondamental opposable à l’État, garant de la dignité et de la pérennité du vivant.
Conclusion
Pour la CSQ, une constitution québécoise doit être la véritable loi fondamentale de la nation et garantir la protection des droits et des libertés fondamenta, notamment la liberté d’association. Elle doit constituer une occasion privilégiée de consacrer les droits économiques et sociaux. Elle ne doit en aucun cas ouvrir la voie à un affaiblissement des droits des femmes. Elle doit aussi consacrer le respect de l’État de droit et la séparation des pouvoirs.
De plus, pour la CSQ, une future constitution doit inscrire explicitement le droit à l’autodétermination des peuples autochtones, conformément à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et aux obligations internationales. Elle doit également instaurer un véritable processus de consultation, assorti de mécanismes de coconstruction avec les gouvernements autochtones et leurs instances représentatives. Finalement, elle doit prévoir des mesures pour revitaliser les langues autochtones et protéger les savoirs traditionnels, afin de respecter les droits linguistiques et culturels.
En considérant l’importance que revêt une constitution pour une nation, il nous apparait essentiel que le processus menant à son adoption respecte des principes fondamentaux. Ces principes doivent inspirer la confiance, légitimer le résultat et favoriser l’adhésion des citoyennes et citoyens à la Constitution.
Ainsi, la CSQ émet la recommandation suivante :
| Recommandation
La Centrale des syndicats du Québec recommande de réviser et de relancer intégralement le processus d’élaboration et d’adoption de la constitution dont le Québec souhaite se doter. Ce processus doit reposer sur un vaste dialogue social et une démarche transparente et participative, incluant la pleine participation des Premières Nations et des Inuit.
|
[1] QUÉBEC (2025). Projet de loi no 1, Loi constitutionnelle de 2025 sur le Québec, [En ligne], Québec, Éditeur officiel du Québec, 43e législature, 2e session. [assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-1-43-2.html].
[2] NATIONS UNIES DROITS DE L’HOMME (2018). Droits de l’homme et élaboration d’une constitution, [En ligne], Nations Unies, p. 15. [www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/
ConstitutionMaking_FR.pdf].
[3] NATIONS UNIES DROITS DE L’HOMME (2018). Droits de l’homme et élaboration d’une constitution, [En ligne], Nations Unies, p. 13-14. [www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/
ConstitutionMaking_FR.pdf].
[4] Communication no 205/1986, Marshall c. Canada (CCPR/C/43/205/1986).
[5] NATIONS UNIES DROITS DE L’HOMME (2018). Droits de l’homme et élaboration d’une constitution, [En ligne], Nations Unies, p. 16. [www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/
ConstitutionMaking_FR.pdf].
[6] CANADA. MINISTÈRE DE LA JUSTICE (2020). La déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, [En ligne], le Ministère, 14 p. [justice.gc.ca/fra/declaration/un_declaration_
FR1.pdf].
[7] CANADA. MINISTÈRE DU PATRIMOINE (2013). Pacte international relatif aux droits civils et politiques – Sixième Rapport du Canada couvrant la période de janvier 2005 à décembre 2009, [En ligne], 44 p. [canada.ca/content/dam/pch/documents/services/canada-united-nations-system/reports-united-nations-treaties/intnl_civil_politique-intnl_civil_political-fra.pdf].
[8] Nation haïda c. Colombie-Britannique (Ministre des Forêts) (2004). 3 RCS 511, [En ligne]. [decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/item/2189/index.do].
[9] CANADA. MINISTÈRE DE LA JUSTICE (1982). Lois constitutionnelles de 1867 à 1982, à jour au 1er janvier 2024, [En ligne], Canada, Ministère de la Justice. [laws-lois.justice.gc.ca/PDF/Const_TRD.pdf].
[10] ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT [s. d.]. Democracy Index 2024, [En ligne]. [eiu.com/n/
campaigns/democracy-index-2024?_gl=1*94fqgw*_ga*MTk1NzYxOTExNy4xNzQ0ODA2NzM4*_
ga_MBKB5H5HCP*czE3NDcxNDU5ODMkbzQkZzEkdDE3NDcxNDYwMjMkajAkbDAkaDA].
[11] Voir par exemple : OCDE (2025). Participation citoyenne au cycle de l’action publique : explorer de nouveaux horizons, Examens de l’OCDE sur la gouvernance publique, [En ligne], Paris, Éditions OCDE, 150 p. [oecd.org/content/dam/oecd/fr/publications/reports/2025/03/exploring-new-frontiers-in-citizen-participation-in-the-policy-cycle_3b33d845/a697cb85-fr.pdf].
[12] POIRIER, Johanne (2015). « Souveraineté parlementaire et armes à feu : le fédéralisme coopératif dans la ligne de mire? », Revue de droit de l’Université de Sherbrooke, [En ligne], vol. 45, nos 1-2, p. 47-131. [erudit.org/fr/revues/rdus/2015-v45-n1-2-rdus08705/1105801ar.pdf].
[13] Centre for Gender Advocacy c. Attorney General of Quebec (2021). CanLII 191 (QCCS).
[14] QUÉBEC (2021). Projet de loi n° 2, Loi portant sur la réforme du droit de la famille en matière de filiation et modifiant le Code civil en matière de droits de la personnalité et d’état civil, [En ligne], Québec, Éditeur officiel du Québec, 42e législature, 2e session. [assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-2-42-2.html].
[15] Truchon c. Procureur général du Canada (2021). CanLII 590 (QCCS).
[16] BARREAU DU QUÉBEC (2025). Le Barreau du Québec craint une érosion de l’état de droit au Québec (13 novembre). Repéré au barreau.qc.ca/fr/salle-presse/communiques-2025/barreau-craint-erosion-etat-droit-quebec/.
[17] Dagenais c. Société Radio-Canada (1994). 3 R.C.S. 835, p. 877.
[18] BOSSET, Pierre (1996). « Les droits économiques et sociaux : parents pauvres de la charte québécoise? », La Revue du Barreau canadien 583, [En ligne], vol. 75-4. [cbr.cba.org/index.php/cbr/article/view/3726/3719].
[19] Tremblay c. Daigle (1989). 2 S.C.R. 530.
[20] DESMARAIS, Louise (1999). La bataille de l’avortement : chronique québécoise 1970-2010, Montréal, Les éditions du remue-ménage, 550 p.
[21] BUSTAMANTE, Paule (2022). « Le Chili pourrait inscrire le droit à l’avortement dans sa Constitution », Agence France-Presse, [En ligne] (27 juin). [lapresse.ca/international/amerique-latine/2022-06-27/le-chili-pourrait-inscrire-le-droit-a-l-avortement-dans-sa-constitution.php].
[22] CARABIN, François (2025). « Deux tiers des Québécois favorables à une constitution du Québec », Le Devoir, [En ligne] (17 octobre). [ledevoir.com/politique/quebec/926106/deux-tiers-quebecois-favorables-constitution-quebec].
[23] PRONOVOST, Véronique, Amélie ROBERT et Suzanne ZACCOUR (2023). Rapport : garantir le droit à l’avortement en renforçant l’accès aux services, [En ligne], 27 p. [api.fqpn.qc.ca/wp-content/uploads/2023/09/F_Rapport_avortementQc.pdf].