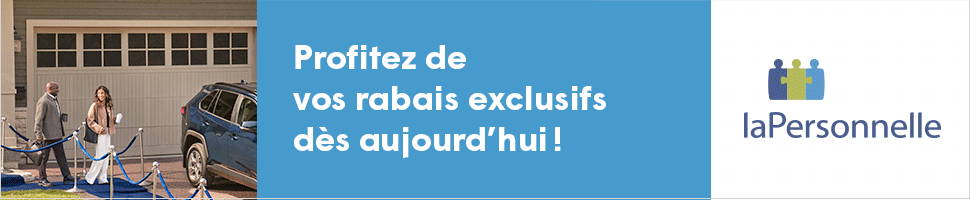Diversité, Éducation
LETTRE OUVERTE | Rapport du Comité de sages: «De forts motifs d’inquiétude»
29 septembre 2025
Plutôt que l’apaisement espéré à la suite du rapport du Comité de sages sur l’identité de genre, les cosignataires observent un recul des droits dans les milieux scolaires.
Par Anne Dionne, vice-présidente de la CSQ, et 19 cosignataires*
Alors que le gouvernement annonce l’interdiction de l’utilisation de mots non binaires et de la rédaction inclusive dans les communications de l’État, on apprenait cette semaine que la mesure sera également appliquée dans le réseau de l’éducation.
En entrevue à l’émission Tout un matin du mercredi 24 septembre 2025, le ministre Jean-François Roberge rappelait que l’abandon de l’écriture inclusive au profit de celle épicène est l’une des recommandations du Comité des sages.
Le rapport, déposé au printemps dernier par le Comité de sages sur l’identité de genre, suscitait l’espoir d’un apaisement des débats et d’une meilleure compréhension collective des réalités encore trop souvent mal comprises. Il devait fournir des repères clairs et des outils concrets afin de favoriser un climat scolaire inclusif, capable d’accueillir dignement la diversité, notamment en ce qui concerne les jeunes trans, les non-binaires et leurs familles.
Or, force est de constater que les conclusions du rapport sont profondément décevantes et préoccupantes, ouvrant plutôt la voie à un recul des droits dans nos établissements d’enseignement.
En tant que membres de la Table nationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie des réseaux de l’éducation, nous sommes particulièrement inquiets des effets que ce rapport pourrait avoir dans les écoles, les cégeps et les universités. En effet, les quelques recommandations concernant ces établissements soulèvent d’importantes préoccupations éthiques, juridiques et sociales.
Une méconnaissance du droit et de la réalité scolaire
Le Comité recommande notamment que les jeunes trans ou non binaires soient encouragés par le personnel scolaire à dévoiler leur identité de genre à leurs parents.
Cette suggestion, formulée comme un simple principe de transparence, contrevient pourtant au droit à la vie privée reconnu aux jeunes dès l’âge de 14 ans, âge auquel ils, elles et iels peuvent prendre des décisions médicales ou juridiques concernant leur identité sans consentement parental.
Insinuer qu’une reconnaissance de leur prénom et de leur pronom dans un établissement scolaire devrait être conditionnée à l’approbation parentale revient à restreindre leurs droits fondamentaux et à les exposer à des situations de vulnérabilité accrues et bien documentées. En effet, sachant que le dévoilement peut entraîner du rejet, des violences psychologiques ou même physiques, cette position est dangereuse et irresponsable.
Une éducation fondée sur l’inclusion remise en question
Depuis plusieurs années, les établissements d’enseignement déploient des efforts considérables pour accueillir et soutenir les jeunes de la diversité sexuelle et de genre avec respect et humanité. Des guides ont été rédigés, et des formations et des politiques d’affirmation ont été mises en place avec l’objectif d’assurer un climat scolaire sain, sécuritaire et exempt de discrimination pour toutes et tous. Ces pratiques s’appuient sur les meilleures données disponibles en matière de pédagogie, de psychologie et de droit.
En remettant en question la validité des pratiques transaffirmatives, le rapport crée la confusion et jette le doute sur des approches qui ont pourtant fait leurs preuves. En laissant entendre que l’utilisation d’un prénom choisi ou la reconnaissance de l’identité de genre à l’école pourrait entraîner une transition médicale précipitée, il perpétue des mythes sans fondement. Il nie aussi le principe fondamental de l’éducation québécoise : accompagner les jeunes dans leur développement, leur autonomie et leur épanouissement, sans jugement.
L’invisibilisation des expertises du Québec
Comme l’ont souligné le Conseil québécois LGBT et le sociologue Michel Dorais, le rapport repose sur une méthodologie discutable, marquée par des biais idéologiques. Il met, sur un même pied, des anecdotes invérifiables et des études scientifiques rigoureuses, tout en évacuant des décennies de recherches menées au Québec et à l’international.
Le rapport présente ainsi une conception réductrice du sexe comme réalité purement biologique et binaire, en contradiction avec les consensus scientifiques contemporains. Il escamote ainsi les réalités vécues par les personnes trans, non binaires ou intersexes, en leur refusant une pleine légitimité. Cette posture est non seulement irrespectueuse, mais elle est aussi indéfendable sur le plan de la recherche et de la pédagogie.
Un climat toxique pour les jeunes et le personnel scolaire
Les conséquences de ce rapport ne sont pas théoriques. Déjà, nous observons un climat alourdi dans les écoles. Le doute semé par ce rapport peut encourager des reculs de pratiques inclusives et valider des discours transphobes, sous couvert de prudence ou « de bon sens ». Quant aux jeunes concernés, ils, elles et iels risquent de se sentir encore plus isolés, incompris, voire mis en danger.
Ce rapport ne doit, en aucun cas, servir de base à une refonte des pratiques éducatives. Au contraire, il est urgent de renforcer ce qui fonctionne déjà : les pratiques inclusives, le respect des droits fondamentaux, la formation du personnel et l’accompagnement bienveillant des jeunes dans leur cheminement.
L’éducation ne peut pas devenir un terrain de recul des droits. Nous devons faire mieux. Et surtout, nous devons faire preuve de courage et de clarté : affirmer que les jeunes trans et non binaires sont pleinement valables et légitimes, dans nos écoles comme dans notre société. Parce que les élèves d’aujourd’hui sont les décideuses et décideurs de demain. Parce que l’éducation doit toujours viser à élever, jamais à exclure.
*Cosignataires :
Membres de la Table nationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie des réseaux de l’éducation : Carolane Desmarais, présidente, Fédération du personnel professionnel de l’éducation (FPPE-CSQ) ; Caroline Senneville, présidente, Confédération des syndicats nationaux (CSN) ; Cédric Bergeron, directeur du Centre de formation des Îles, Centre de services scolaire des Îles ; Christopher Zéphyr, président, Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) ; Comité pour la diversité sexuelle et l’identité de genre, Centrale des syndicats du Québec (CSQ) ; Éric Pronovost, président, Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS CSQ) ; Flora Dommanget, présidente, Union étudiante du Québec (UEQ) ; Frédéric Brun, président, Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) ; Freya Dogger, enseignante et représentante de la Fédération des enseignantes et enseignants de cégep (FEC-CSQ) ; Gislain Tardif, enseignant et représentant de la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ) ; Heidi Yetman, présidente, Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec (APEQ) ; John Cuffaro, vice-président, Fédération du personnel de soutien de l’enseignement supérieur (FPSES-CSQ) ; Manon Labrecque, deuxième vice-présidente à la gestion administrative, Fédération du personnel de l’enseignement privé (FPEP-CSQ) ; Marc Pepin, conseiller pédagogique et représentant de la Fédération du personnel professionnel des collèges (FPPC-CSQ) ; Patrick Bydal, vice-président à la vie politique, Fédération autonome de l’enseignement (FAE) ; Ryan W. Moon, vice-président, Fédération des professionnèles (FP-CSN) ; Sophie Ferguson, deuxième vice-présidente, Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) ; Vincent Leclair, secrétaire général, Conseil régional FTQ Montréal-Métropolitain et coprésident du Comité sur la diversité sexuelle, corporelle et de genre de la FTQ ; Yves de Repentigny, vice-président, Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN)