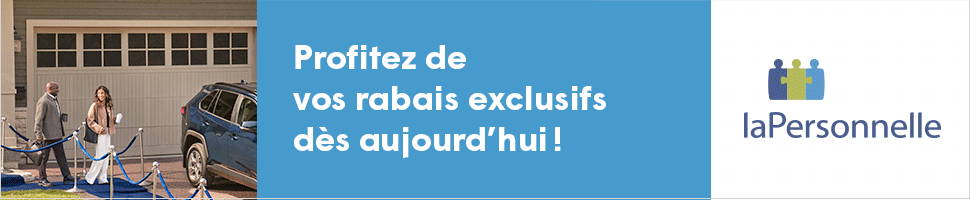Société
Itinérance au féminin: invisibles dans la rue
4 novembre 2025
Derrière les slogans d’égalité, le Québec continue de produire des trajectoires de précarité spécifiquement féminines. Ce n’est pas un hasard si l’itinérance augmente deux fois plus vite chez les femmes que chez les hommes : c’est le résultat direct d’un système qui érode les liens sociaux, multiplie les violences et rend invisibles celles qu’il prétend protéger.
Par Félix Cauchy-Charest, conseiller CSQ
C’est ce que sont venues expliquer Mary-Lee Plante et Frédérique Rivest du Regroupement d’aide aux itinérantes et itinérants de Québec (RAIIQ) lors du réseau d’action féministe de la CSQ, qui a eu lieu à la veille de la Marche mondiale des femmes 2025.
Elles ont rappelé que l’itinérance féminine n’est pas toujours visible dans la rue. Elle se cache parfois chez des proches, dans des abris improvisés ou encore dans des logements insalubres ou trop chers.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : en 2022, 29 % des personnes en situation d’itinérance au Québec étaient des femmes. Parmi elles, 91 % ont vécu une agression au cours de leur vie. Cette donnée, à elle seule, devrait suffire à faire du droit au logement un enjeu féministe majeur.

Quand la violence mène à la rue
La rue n’est jamais un premier choix, selon Mary-Lee Plante et Frédérique Rivest. Beaucoup de femmes y arrivent après avoir épuisé toutes les autres options : tolérer la violence d’un conjoint afin de conserver un toit, se taire devant un propriétaire abusif, accepter un emploi sous-payé pour subvenir aux besoins des enfants. D’ailleurs, près d’une femme sur trois en situation d’itinérance est cheffe de famille monoparentale.
L’itinérance féminine est parfois le prolongement de situations de violence conjugale, économique et systémique. Elle se nourrit d’une culture où la dépendance matérielle demeure la norme et où la sécurité des femmes dépend encore de la « bonne volonté » des hommes ou de l’État.
Et quand les femmes franchissent enfin les portes des ressources, trop souvent, elles ne trouvent pas un refuge, mais un système pensé pour d’autres : seulement 10 % des lits d’urgence leur sont réservés. Beaucoup refusent d’y aller par peur des environnements mixtes, de la stigmatisation ou de perdre la garde de leurs enfants.
Les angles morts des politiques publiques
On parle beaucoup de la crise du logement, mais peu de la manière dont elle frappe les femmes, ont rappelé Mary-Lee Plante et Frédérique Rivest. Au total, 206 000 femmes vivraient dans un logement qui ne correspond pas à leur capacité financière. Plus de 25 000 consacreraient plus de 80 % de leur revenu à se loger. Cette réalité transforme chaque séparation, chaque perte d’emploi, chaque hausse de loyer en risque d’itinérance.
Et derrière ces statistiques se cachent des histoires concrètes : des enseignantes contraintes d’habiter dans un garage, des travailleuses à temps plein incapables de trouver un logement à moins de 2 000 $ par mois, des femmes âgées poussées dehors après la mort d’un conjoint. Ce ne sont malheureusement pas des exceptions, ont dit les intervenantes du RAIIQ.
Une intersection de précarités
Les visages de l’itinérance féminine sont multiples : femmes autochtones, migrantes, aînées, en situation de handicap. Les unes cumulent le racisme, les autres l’exclusion linguistique ou les obstacles physiques. Dans chaque cas, l’itinérance devient un révélateur : nos politiques publiques ne protègent pas celles qui cumulent les discriminations, elles les abandonnent à la marge.
Chez les femmes autochtones, la surreprésentation est dramatique : elles représentent 48 % des admissions en détention fédérale et subissent la violence à un taux trois fois supérieur aux femmes allochtones. Chez les femmes immigrantes, la peur de perdre un statut légal ou l’absence de services adaptés complique tout accès à l’aide. Et chez les femmes en situation de handicap, à peine une maison d’hébergement sur trois est accessible.
Repenser la solidarité
Au réseau d’action féministe de la CSQ, les participantes ont été nombreuses à s’exprimer sur le sujet, à trouver qu’il est urgent de replacer l’itinérance au cœur du féminisme québécois.
Les solutions existent : logements sociaux sécuritaires, financement durable des organismes communautaires, politiques publiques qui reconnaissent la réalité des femmes plutôt que de l’effacer. Elles exigent cependant un changement de regard : cesser de parler d’échec individuel pour parler de défaillance collective.
Quand une femme perd son logement, c’est tout un filet social qui se défait. Et c’est toute une société qui doit décider si elle choisit de tisser de nouveaux liens… ou de détourner le regard.