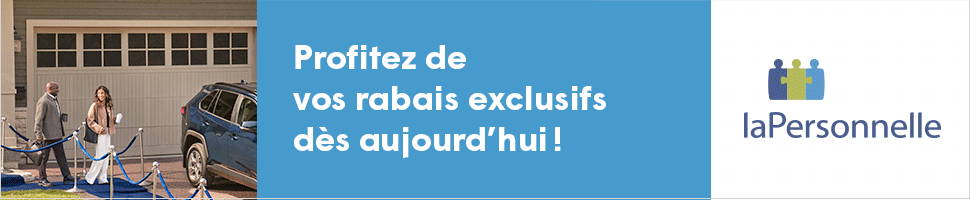Éducation, Enseignement supérieur
Compressions budgétaires : le miroir des choix politiques
5 novembre 2025
Depuis près d’un an, le gouvernement de François Legault multiplie les annonces crève-cœur pour le réseau de l’éducation et celui de l’enseignement supérieur : gel de l’embauche, compressions budgétaires, plafonds d’équivalent temps complet (ETC) et autres. Il est important de situer ces décisions dans leurs contextes économique et politique pour mieux les comprendre et, surtout, mieux les combattre.
Par François Desrochers, conseiller CSQ
L’épouvantail du déficit
Les choix budgétaires du gouvernement Legault ne découlent pas de contraintes économiques externes l’obligeant à procéder à des compressions. Rappelons que ce gouvernement a réduit à plusieurs reprises les taxes et les impôts des personnes les plus fortunées au cours de ses 2 mandats, se privant ainsi d’environ 4 milliards $ par année pour financer les missions essentielles de l’État. Ces baisses d’impôt inutiles expliquent en grande partie le déficit budgétaire persistant.
L’excuse du déficit, utilisée pour justifier les compressions, est donc une construction du gouvernement lui-même. Plutôt que de financer les services publics à la hauteur de leurs besoins le gouvernement Legault a préféré forcer l’ensemble de la population à se serrer la ceinture.
La logique budgétaire derrière les compressions
Depuis l’arrivée au pouvoir de François Legault, les centres de services scolaires (CSS) et les commissions scolaires (CS) ont presque toujours dépensé davantage que les sommes initialement allouées.
Ainsi, l’augmentation des budgets s’explique moins par des investissements planifiés par le gouvernement que par des déficits acceptés à postériori. Les CSS et les CS sont arrivés à ces dépassements de coûts simplement en appliquant les règles budgétaires selon leurs réalités locales. En fin d’exercice, le gouvernement n’avait souvent d’autre choix que d’éponger le manque à gagner.
Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette situation : gestion déficiente, mauvais indicateurs d’évolution des besoins, etc. Il n’est toutefois pas anodin que ces dépassements surviennent dans un contexte de déficits budgétaires chroniques à Québec. Nous pouvons raisonnablement supposer que le gouvernement a eu tendance à minimiser les besoins du réseau scolaire.
« Aucun gouvernement n’a jamais autant investi dans l’éducation »
Cette affirmation de l’ex-ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, pour justifier ses compressions, n’est qu’une demi-vérité. En effet, les budgets de l’éducation – tout comme le produit intérieur brut (PIB) – atteignent presque toujours des records en dollars, simplement en raison de l’inflation et de la croissance démographique. Il faut donc comparer les budgets d’une année à l’autre en tenant compte de l’évolution des besoins des élèves et de notre richesse collective.
Une certaine prise de conscience dans la société a amené le réseau scolaire à s’intéresser davantage aux élèves présentant des handicaps et/ou des difficultés d’adaptation ou d’apprentissage. Plus d’évaluations sont réalisées, permettant à plus de jeunes de bénéficier de plans d’intervention adaptés à leur réalité. Plusieurs enfants qui auraient été laissés à eux-mêmes à une autre époque sont maintenant accompagnés tout au long de leur parcours.
Il reste encore beaucoup à faire, mais cette évolution de la proportion d’élèves HDAA démontre que nous ne pouvons pas comparer les budgets de deux années différentes sans tenir compte de l’évolution des besoins.
Malgré les sommes réinjectées dans le réseau scolaire depuis l’arrivée au pouvoir de la Coalition avenir Québec (CAQ), ce gouvernement n’a fait que réparer une partie des dommages infligés par l’austérité libérale du gouvernement Couillard. La proportion du PIB consacrée aux réseaux scolaire et collégial est en effet revenue à son niveau de 2014-2015, mais demeure inférieure à l’ère du gouvernement de Jean Charest. Vu sous cet angle, il est donc faux de prétendre qu’aucun gouvernement n’a autant investi en éducation.
L’énergie du désespoir
Nous faisons face à un gouvernement fatigué, en fin de mandat, qui tente désespérément de sauver les meubles. Avec seulement 16 % des intentions de vote, la CAQ n’a jamais été aussi impopulaire depuis sa création en 2011.
François Legault ne peut donc réalistement espérer se maintenir au pouvoir, mais il peut chercher à conserver quelques bastions régionaux. Ces régions sont celles où le discours prônant la réduction de la taille de l’État et du fardeau fiscal est le mieux accueilli. Ce déclin en popularité donne aussi au gouvernement l’occasion de mettre en œuvre des politiques plus idéologiquement marquées, qu’il avait jusqu’ici mises de côté pour préserver une image « centriste » susceptible de lui faire gagner une majorité de circonscriptions.
Le premier ministre a d’ailleurs promis un « traitement choc » dans la fonction publique, menaçant d’abolir 6 000 postes d’ici la fin de son mandat. La justification derrière toutes ces attaques contre les services publics est la volonté du gouvernement de retrouver l’équilibre budgétaire le plus rapidement possible.
La fonction publique, souvent mal comprise du grand public, est une cible facile. Le vieux préjugé selon lequel elle serait composée de bureaucrates inutiles ne s’applique pourtant pas aux services publics d’éducation ni de santé et services sociaux.
Les compressions dans le réseau scolaire et les cégeps, suivies du réinvestissement annoncé dans les CSS et les CS, s’accompagnent d’une consigne claire : éviter autant que possible de nuire aux services à la population. En filigrane, le message est que le personnel n’offrant pas de services directs n’est pas essentiel.