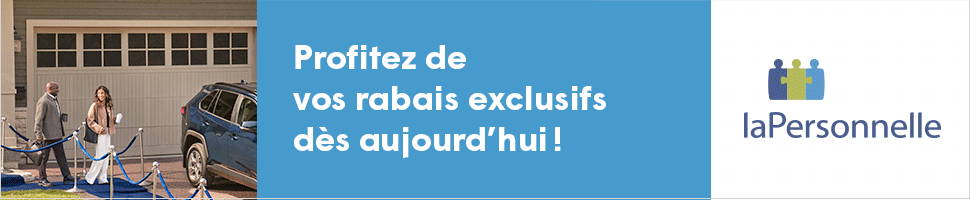Cultures et réalités autochtones, Société
Des savoirs ancestraux, un avenir commun
19 novembre 2025
Le réseau du Mouvement ACTES, tenu à Wendake les 6 et 7 novembre derniers, relevait moins de la conférence que d’un véritable déplacement intérieur. En deux jours, entre chants de gorge, réflexions collectives, ateliers ancrés dans le territoire et discussions parfois déstabilisantes, quelque chose s’est déposé : une nouvelle manière de regarder notre rôle en éducation. Et surtout, une relation renouvelée au territoire que nous partageons.
Par Félix Cauchy-Charest, conseiller CSQ
Dès l’arrivée à Wendake, l’accueil chaleureux donnait le ton : ici, on ne « consomme » pas une formation, on entre dans une relation. La cérémonie d’ouverture du réseau, suivie du chant de gorge katajjaniq de Nina Segalowitz, a créé une ambiance qui dépasse les mots. Les vibrations remplissaient la salle de réunion de l’Hôtel-Musée des Premières Nations de Wendake, en plein territoire Wendat, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle.
Puis la table ronde intitulée Savoirs ancestraux, avenir commun a ouvert la réflexion de manière frontale et généreuse. Les savoirs autochtones ne sont pas un supplément culturel décoratif, mais une manière complète d’être au monde. On sentait une sincérité désarmante, loin des discours abstraits. Langue, famille, art, guérison, éducation : tout cela en même temps, parce que, dans ces visions du monde, tout est lié.
Cette discussion a laissé plusieurs d’entre nous avec la même impression : si l’éducation veut vraiment contribuer à un avenir plus juste, il faut accepter de se décentrer, de réapprendre et de douter.
Langue, écorce, histoires
L’après-midi offrait trois portes d’entrée vers les savoirs autochtones, et chacune avait son propre rythme.
Dans l’atelier L’éveil de la langue wendat, on suivait le parcours d’un homme qui a participé à ramener à la vie une langue en dormance. Ce n’était pas un exposé magistral, mais un témoignage vibrant et parfois fragile. On prenait conscience que, derrière un mot enseigné en classe, il y a des décennies de travail, d’archives dépoussiérées, de conversations avec des aînés et de moments de doute. Apprendre quelques mots en wendat, ce jour-là, n’était pas anecdotique : c’était un geste relationnel.
Pendant ce temps, dans un autre atelier, Pinock Smith présentait un canot d’écorce fait main. Le genre d’objet que l’on croit connaître… jusqu’à ce qu’on entende ce qu’il représente. Racines, fibres, gestes, climat, cycles de la forêt : tout s’entremêlait. L’aspect artisanal a été abordé, mais aussi les changements climatiques, la pollution, la mémoire du territoire, les savoirs en danger. À la sortie, plusieurs participantes et participants avaient l’impression d’avoir reçu une leçon d’écologie, d’histoire et de philosophie.
Raconter, ce n’est pas seulement divertir. Dans les nations autochtones, le récit est un véhicule de connaissances : orientation, éthique, écologie, appartenances. Les participantes et participants sont repartis avec l’envie de redonner au conte sa place pleine dans nos pratiques pédagogiques.
La journée s’est conclue avec les mots des partenaires, la présentation d’une série de courts métrages marquants réalisés par des Autochtones, puis, pour celles et ceux qui l’avaient choisi, l’expérience nocturne Onhwa’ Lumina, une marche lumineuse qui donne l’impression de traverser un récit vivant, quelque part entre le mythe fondateur et un futur qui reste à écrire ensemble.
Littérature, histoire, alliances et spiritualité
La deuxième journée du réseau a été tout aussi dense que la première, mais avec un rythme plus introspectif.
L’atelier Je lis autochtone! a offert une plongée aux participantes et participants dans la littérature autochtone, une manière d’apprendre à choisir, de présenter et de contextualiser les œuvres. Plusieurs éducatrices et éducateurs présents à l’événement ont pris bonne note des bibliographies, des conseils, des repères, des mises en garde, etc. C’était concret, applicable et nécessaire.
De son côté, l’atelier sur les trousses pédagogiques pour décoloniser l’histoire proposait des outils clés en main pour renouveler l’enseignement de l’histoire. Là encore, la même impression : il est possible d’enseigner autrement, et les ressources existent.
Matricentrisme, alliances et spiritualités
Trois ateliers complémentaires ont mené les participantes et participants complètement ailleurs. L’un de ceux-là portait sur le matricentrisme wendat, qui relie la cosmologie wendat, l’écoféminisme et une réflexion profonde sur notre place dans le monde. Un autre abordait la spiritualité autochtone, construite autour d’un casse-tête géant révélant la profondeur et la cohérence des perspectives spirituelles autochtones. Le dernier atelier, Être alliées et alliés des Premières Nations, a abordé avec vulnérabilité l’histoire, l’ancrage et les responsabilités.
Tous ces ateliers partageaient les mêmes objectifs : donner des clés pour agir avec respect, lucidité et courage afin de retrouver notre place dans la nature, et non au-dessus de celle-ci.
Un avenir commun qui commence par l’écoute
Le réseau du Mouvement ACTES s’est terminé par un cercle de parole, un moment simple et sincère, où plusieurs ont nommé les mêmes choses : gratitude, prise de conscience, inconfort parfois, mais surtout désir d’aller plus loin.
Si Wendake nous a appris une chose, c’est que les savoirs ancestraux ne sont pas un héritage figé. Ce sont des directions, des invitations à repenser notre manière d’enseigner, de vivre ensemble et de préparer l’avenir. Un avenir qui ne pourra être commun que si nous apprenons d’abord à écouter.