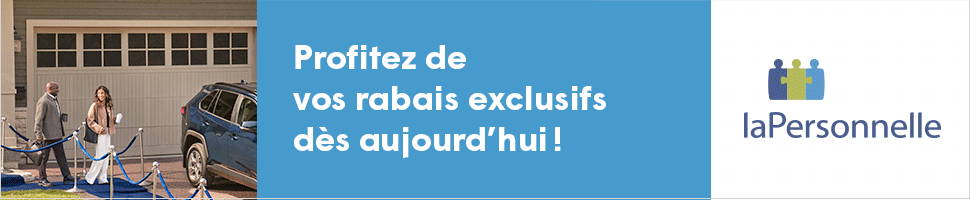Éducation
Loi 2 en Alberta : un précédent inquiétant pour le Québec
5 novembre 2025
En Alberta, le gouvernement conservateur a adopté à la hâte le Back to School Act (Loi 2), une loi spéciale forçant le personnel enseignant à reprendre le travail après une grève historique pour de meilleures conditions dans les écoles. En invoquant la clause dérogatoire de la Charte canadienne des droits et libertés, le gouvernement albertain de Danielle Smith s’est inspiré du gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ) et a suspendu temporairement les protections constitutionnelles entourant la liberté d’association et le droit de grève.
Par Félix Cauchy-Charest, conseiller CSQ
Cette manœuvre autoritaire, saluée par le patronat, mais dénoncée par l’Alberta Teachers’ Association (ATA), ne réglera rien à la crise qui mine les écoles albertaines : classes surchargées, manque de ressources et conditions de travail intenables (voir à ce sujet notre entrevue menée avec Robert Mazzotta, secrétaire exécutif de l’ATA). Elle impose des sanctions financières sévères aux syndiquées et syndiqués et aux associations locales qui refuseraient de s’y soumettre, tout en interdisant toute contestation judiciaire. Pour les profs, c’est une double peine : perdre le droit de se défendre et le droit de se faire entendre.
La dérive autoritaire s’installe
Ce n’est pas la première fois qu’un gouvernement au Canada utilise une loi spéciale pour briser une grève. Toutefois, l’ampleur du recours à la clause dérogatoire en Alberta frappe par son cynisme : suspendre des droits fondamentaux pour imposer le silence aux travailleuses et travailleurs de l’éducation. C’est un signal inquiétant pour tout le mouvement syndical. Car au-delà du prétexte de la continuité des services, c’est l’idée même de la négociation libre et de la démocratie au travail qu’on attaque.
Ce précédent ne devrait pas être lu comme un simple épisode régional. Il résonne dangereusement jusqu’ici, au Québec, où le gouvernement Legault emprunte le même chemin avec sa propre Loi 2 — adoptée, elle aussi, sous bâillon. Cette loi encadre et limite la liberté d’action des médecins en leur imposant des quotas de patients et en prévoyant des sanctions contre les moyens de pression collectifs. Là encore, l’État choisit la coercition plutôt que la concertation.
Québec : la même logique de contrôle
En Alberta, le « Bill 2 » est justifié au nom de « l’intérêt supérieur des élèves ». Au Québec, la Loi 2 est défendue au nom de « l’accès aux soins ». Dans les deux cas, la rhétorique est la même : les droits collectifs deviennent des obstacles à la performance du système.
Cette approche technocratique déshumanise les professions et infantilise celles et ceux qui les exercent. Plutôt que d’écouter les travailleuses et travailleurs sur le terrain, on leur impose des règles par décret et on criminalise leur résistance.
Les réactions, elles, ne trompent pas : en Alberta, les représentantes et représentants du personnel enseignant parlent d’un « jour sombre pour l’éducation publique ». Au Québec, la Fédération des médecins omnipraticiens et le Collège des médecins dénoncent une « loi punitive » qui risque d’aggraver la crise d’accès aux soins. Dans les deux provinces, les professionnelles et professionnels sont réduits au silence, alors qu’ils alertent depuis des années sur les effets des compressions, de la centralisation et du manque de reconnaissance.
Un même combat pour la liberté syndicale
« C’est l’idée même du droit d’association qui est attaquée ici, explique Éric Gingras, président de la CSQ. Depuis l’arrêt Saskatchewan de la Cour Suprême, on sait que le droit de véritablement négocier et d’exercer le droit de grève fait partie intégrante du droit d’association. »
Ces deux lois s’inscrivent dans une tendance nord-américaine où l’on tente de neutraliser la force collective du monde du travail. Qu’il s’agisse des hôpitaux ou des écoles, la logique est identique : encadrer, discipliner, isoler.
Pourtant, les luttes syndicales ne menacent pas la population; elles la protègent. Ce sont les grèves qui ont permis les ratios plus humains, les congés parentaux, la sécurité au travail et le maintien d’un réseau public de qualité.
En réduisant le droit de grève à une nuisance, les gouvernements trahissent la base même de la démocratie sociale. Ils veulent faire taire celles et ceux qui rappellent que les services publics ne peuvent survivre sans respect des travailleuses et travailleurs qui les portent.
Solidarité d’un océan à l’autre
À la CSQ, nous ne pouvons rester spectateurs. L’attaque contre les enseignantes et les enseignants de l’Alberta nous concerne toutes et tous. Ce qui se joue là-bas, c’est le droit de dire non. Le droit de défendre ses élèves, ses patients, son milieu. Le droit d’exiger que les décisions publiques se prennent avec, et non contre, celles et ceux qui font vivre nos écoles et nos hôpitaux.
« Quand l’Alberta suspend la Charte pour forcer un retour au travail, et que le Québec impose le bâillon pour museler ses médecins, c’est le même fil rouge : celui d’un pouvoir qui préfère gouverner par la peur plutôt que par le dialogue », déplore Éric Gingras.
La solidarité syndicale doit franchir les frontières provinciales. Parce que l’éducation et la santé publiques ne peuvent se défendre seules, parce que le droit de grève est un pilier de la démocratie, parce que le silence imposé aux travailleuses et aux travailleurs d’une province pave la voie à la répression des droits des autres. « Comme travailleuses et comme travailleurs, on se doit d’être solidaires », rappelle le président de la CSQ.