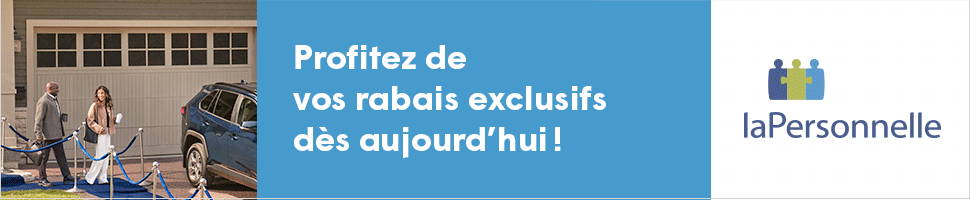Éducation, International
Défendre l’école, c’est défendre la démocratie
3 novembre 2025
Dans son essai percutant Why Fascists Fear Teachers, la présidente de l’American Federation of Teachers, Randi Weingarten, décortique la guerre culturelle qui vise l’école publique aux États-Unis. Mais le diagnostic dépasse largement les frontières américaines : il trouve un écho particulier au Québec, où les éducatrices et éducateurs ainsi que le personnel enseignant et celui du réseau public affrontent, eux aussi, les mêmes vents contraires.
Par Félix Cauchy-Charest, conseiller CSQ
Comme un appel à la vigilance
Why Fascists Fear Teachers s’ouvre comme une fable héroïque. En 1940, des enseignants norvégiens refusent de plier au régime nazi. Pour afficher leur unité, ils arborent discrètement un trombone sur le revers de leurs vestons ou de leurs chemises. Ce geste minuscule, répété des milliers de fois, devient un puissant symbole de résistance.
Randi Weingarten en tire une leçon : les enseignantes et enseignants représentent une menace pour les régimes autoritaires, car ils apprennent aux gens à penser. Ce ne sont ni les multiplications ni la grammaire qui dérangent, mais bien l’éducation à la liberté, à la solidarité et à la pensée critique.
Une rhétorique militante nécessaire
La plume de Randi Weingarten est celle d’une syndicaliste aguerrie, d’une femme de terrain plutôt que d’une universitaire. Elle écrit comme on manifeste : avec urgence et conviction. Sa conviction, c’est que garder le silence face aux dérives autoritaires, c’est en devenir complice. Ce ton direct, parfois intense, est à la hauteur des enjeux qu’elle dénonce. On y retrouve d’ailleurs des arguments qui résonnent familièrement de ce côté-ci de la frontière : défendre l’éducation publique, c’est défendre un modèle de société.
L’autrice parle d’un pays où la droite radicale multiplie les interdictions de livres, s’attaque aux programmes d’histoire critique et tente de détourner les fonds publics vers des écoles privées confessionnelles. Sous-financement, dévalorisation du personnel et privatisation des services sont autant d’échos à l’actualité récente ici même au Québec.
Les fonctions vitales de l’enseignement
Randi Weingarten structure son essai autour de quatre fonctions vitales de l’enseignement, celles qui, selon elle, font craindre les profs aux régimes autoritaires :
1. Le personnel enseignant développe la pensée critique.
À l’ère de la désinformation et des discours d’influenceurs, enseigner à douter, comparer et raisonner devient un geste politique. Attaquer la liberté académique et l’autonomie professionnelle, c’est miner la capacité de réfléchir collectivement.
2. Les écoles publiques sont des milieux sûrs et inclusifs.
Elles accueillent tout le monde, peu importe la langue, le statut social ou les capacités. Mais les politiques d’austérité et la montée de l’intolérance fragilisent cette mission universelle.
3. L’école ouvre les portes de l’avenir.
L’éducation publique est le principal levier d’égalité des chances. Quand le réseau s’effrite, c’est la mobilité sociale qui vacille. Le manque de ressources, les ratios intenables et la pénurie de personnel minent cet idéal d’émancipation.
4. Les travailleuses et les travailleurs de l’éducation s’organisent.
Pour l’autrice, le syndicalisme prolonge la pédagogie : apprendre à se solidariser, à revendiquer. Les syndicats, écrit-elle, sont la démocratie en action. Au Québec aussi, les luttes du personnel scolaire incarnent cette philosophie du bien commun.
La désinformation, terreau du fascisme
Randi Weingarten consacre une partie de son livre à la mécanique de la peur. Elle montre comment les dirigeants autoritaires exploitent la confusion, alimentent les théories du complet et fabriquent des ennemis : immigrants, minorités, personnels syndiqués, fonctionnaires, etc.
Cette stratégie rappelle certaines tendances locales : attaques contre les médias, suspicion envers les institutions, montée du cynisme. Le danger est rarement spectaculaire. Il érode lentement le sens critique et la confiance collective.
Pour l’autrice, chaque salle de classe devient un bastion de démocratie, un lieu où l’on apprend à distinguer le vrai du faux, à écouter et à débattre. Enseigner, écrit-elle, c’est rallumer la lumière dans un monde qui s’habitue à l’obscurité.
Parler du terrain
Ce qui distingue l’ouvrage, c’est son ancrage dans le réel. Randi Weingarten ne se présente ni en héroïne, ni en narratrice distance. Elle reconnaît ses erreurs, notamment durant la pandémie, lorsque les syndicats américains ont été accusés d’avoir retardé le retour en classe. Cette honnêteté donne du poids à son propos.
Elle se montre aussi profondément humaine. L’enseignement, pour elle, n’est pas qu’un métier : c’est une éthique du soin collectif. On pense aux travailleuses du care qui maintiennent chaque jour un système public fragilisé.
Une lecture essentielle pour le mouvement syndical
L’intérêt de l’essai Why Fascists Fear Teachers ne tient pas seulement à sa défense de l’éducation : il rappelle que l’école est politique, au sens noble du terme. Ce que redoutent les fascistes, dit l’autrice, ce n’est pas la pédagogie, mais la conscience citoyenne qu’elle éveille.
Au Québec, où l’école publique demeure un pilier de l’identité collective, le livre agit comme un avertissement : on ne perd pas la démocratie d’un coup, mais par une série de reculs, quand on tolère les coupes, qu’on banalise la privatisation ou qu’on dénigre le personnel.
L’essai est à la fois un cri du cœur et un plan de match. Son écriture sans détour en fait un outil de mobilisation plus qu’un traité d’idées. Mais derrière les slogans se cache une vérité simple : chaque fois que l’école défend la curiosité, l’équité et la solidarité, elle affaiblit les fondations de l’autoritarisme.
Dans un Québec où le réseau public est sous pression et où la confiance envers les institutions s’effrite, le message de Randi Weingarten résonne avec urgence : protéger nos écoles, c’est protéger notre démocratie.