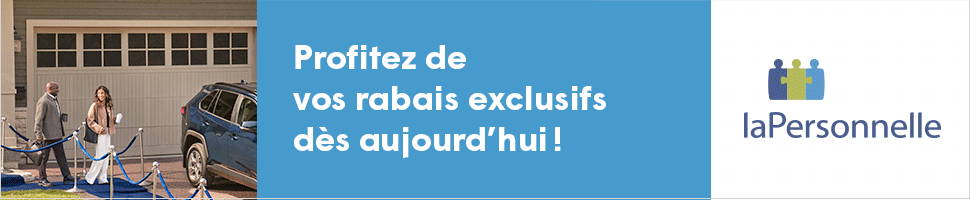Éducation, Société
Une étude de l’UQTR se penche sur les codes vestimentaires scolaires
24 septembre 2025
Une thèse récente de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) démonte pièce par pièce les logiques disciplinaires qui encadrent – et parfois étouffent – l’expression vestimentaire des élèves du secondaire. Résultat : derrière les discours sur la « bonne tenue » se cache un arsenal de règles qui alimentent la stigmatisation, renforcent les inégalités et freinent l’apprentissage de l’autonomie.
Par Félix Cauchy-Charest, conseiller CSQ
L’étude, menée à partir de groupes de discussion dans quatre écoles secondaires québécoises, met en lumière un fossé générationnel : là où plusieurs adultes voient dans le code vestimentaire un outil de respect et d’ordre, nombre d’élèves y perçoivent un instrument de contrôle, souvent teinté de sexisme et d’arbitraire.
Les mesures coercitives – avertissements, exclusions de classe, humiliations publiques – laissent des traces : honte, sentiment d’exclusion, perte de confiance. Le tout, dans un climat scolaire où l’insécurité devient un outil de gestion.
« Apprendre à se conformer » … ou à se connaître?
Le chercheur, Aurel Lewis St-Pierre, pointe un problème central : en voulant imposer une apparence conforme, l’école oublie sa mission première – former des citoyennes et citoyens capables de jugement critique. Les interventions actuelles manquent d’écoute et de nuance, et trop souvent, les élèves les plus visés sont les filles ou les jeunes qui sortent des normes dominantes.
L’étude documente aussi la résistance. Des mouvements comme celui des carrés jaunes, qui a vu le jour à l’école secondaire Joseph-François-Perrault à Québec en 2018 pour dénoncer les codes vestimentaires imposés aux filles, montrent que la jeunesse n’avale pas sans broncher les injonctions vestimentaires. Ces mobilisations réclament un espace de dialogue et un véritable respect de la diversité corporelle, culturelle et identitaire.
Ce qu’on peut changer dès maintenant
La thèse ne se contente pas de critiquer. Elle propose des pistes concrètes. Parmi elles :
- Réécrire les codes vestimentaires avec les élèves : les impliquer dans la définition de règles inclusives, non genrées et respectueuses des réalités diverses;
- Former le personnel : comprendre l’impact psychologique et social des sanctions liées à l’apparence;
- Ouvrir le dialogue : tenir des espaces réguliers de discussion éthique en classe;
- Changer de posture : passer d’une logique punitive à une approche pédagogique centrée sur l’autonomie et le respect mutuel;
- Limiter la surveillance intrusive : privilégier le soutien et l’accompagnement plutôt que le contrôle.
Une question d’équité et de démocratie scolaire
Au fond, l’enjeu dépasse largement la longueur d’un short ou la largeur d’une bretelle. Il s’agit de décider quel type d’école nous voulons : un lieu qui fabrique des conformistes ou un espace où les jeunes apprennent à se connaître, à se respecter et à vivre ensemble dans la diversité.