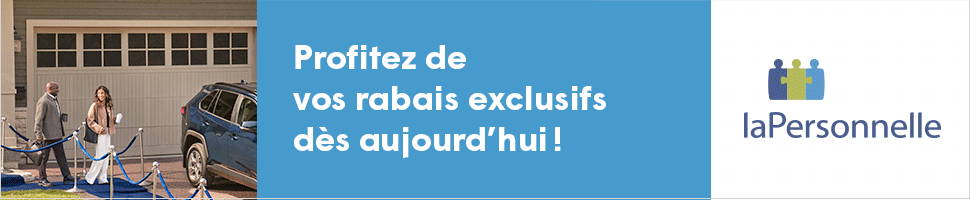Lorsque la prévention ne suffit pas, une intervention est primordiale. La prise en charge de la ou des victimes et des témoins est essentielle, tout comme la mise en place de mesures pour que la situation ne se reproduise pas.

-
Encadrements légaux
La violence au travail, quelle qu’en soit l’origine ou la forme, peut avoir des effets importants sur la santé physique et psychologique de la personne qui en est victime, mais aussi de celles qui en sont témoins.
Deux lois sont particulièrement utiles à connaitre :
- La Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST), qui porte sur la prévention;
- La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP), qui traite de l’indemnisation des lésions professionnelles et de leurs conséquences.
La LSST énonce, pour les travailleuses et travailleurs, le droit à des conditions de travail qui respectent leur santé, leur sécurité et leur intégrité physique. L’objet de cette loi, comme édicté à l’article 2, concerne l’élimination à la source même des dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique et psychique des travailleuses et travailleurs.
Ce droit est aussi reconnu par la Charte des droits et libertés de la personne du Québec et, quoiqu’en des termes un peu différents, par le Code civil du Québec, lequel ajoute la notion de dignité.
De plus, la Loi sur les normes du travail (LNT) stipule que toute salariée ou tout salarié a droit à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique et impose à l’employeur l’obligation de prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique et pour faire cesser une telle conduite lorsqu’elle est portée à sa connaissance.
-
Obligations et droits des travailleuses et travailleurs
Selon l’article 49 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST), les travailleuses et travailleurs sont soumis à certaines obligations :
- Prendre les mesures nécessaires pour protéger leur santé, leur sécurité et leur intégrité physique ou psychique
- Veiller à ne pas compromettre la santé, la sécurité ou l’intégrité physique ou psychique des autres personnes présentes sur les lieux de travail
- Participer à l’identification et à l’élimination des risques de lésions professionnelles sur les lieux de travail
Assurer un milieu de travail sain et sécuritaire constitue une responsabilité légale de l’employeur, comme prévu par la LSST. Toutefois, en imposant également des obligations aux travailleuses et travailleurs, la loi en fait une responsabilité partagée. Chaque personne a le devoir de veiller à sa propre sécurité, tout en contribuant à celle de ses collègues.
Participer à identifier les risques de violence et collaborer à leur élimination est un des meilleurs moyens de prévention. Inscrire dans le registre prévu à cet effet tous les événements de violence dont on peut être victime ou témoin permet une meilleure connaissance des risques et facilite la priorisation des actions à prendre, en mesurant les niveaux de récurrence et de gravité des conséquences.
La LSST reconnait aux travailleuses et travailleurs ce qui est communément nommé le droit de refus (article 12). Il s’agit du droit de refuser d’exécuter leur travail s’ils ont des motifs raisonnables de croire qu’ils s’exposent ou exposent autrui à un danger pour leur santé, leur sécurité ou leur intégrité physique ou psychique.
Ce droit est toutefois limité si le refus met en péril la vie, la santé, la sécurité ou l’intégrité physique ou psychique d’une autre personne, ou si les conditions d’exécution de ce travail sont normales dans le genre de travail qu’il exerce (article 13 de la LSST).
Néanmoins, l’exercice du droit de refus peut être une mesure envisagée en dernier recours lorsqu’une situation perdure, car il peut faciliter la participation d’intervenantes ou d’intervenants externes habilités à juger du niveau de dangerosité et des mesures à mettre en place pour sécuriser l’exécution des tâches.
-
Obligations de l’employeur
L’article 51 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) précise les obligations générales de l’employeur, dont celle de prévenir les situations de violence. Cet article comporte d’ailleurs un paragraphe qui concerne spécifiquement la violence et qui exige de l’employeur des mesures pour protéger les travailleuses et travailleurs, prévenir et faire cesser une situation de violence (paragraphe 16°).
D’autres obligations de l’employeur énoncées à l’article 51 de la LSST peuvent contribuer à prévenir les situations de violence envers le personnel, dont celles‑ci :
- S’assurer que les établissements sur lesquels il a autorité sont équipés et aménagés de façon à assurer la protection du travailleur.
- S’assurer que l’organisation du travail et les méthodes et techniques utilisées pour l’accomplir sont sécuritaires et ne portent pas atteinte à la santé du travailleur.
- Utiliser les méthodes et techniques visant à identifier, contrôler et éliminer les risques pouvant affecter la santé et la sécurité du travailleur.
- Informer adéquatement le travailleur sur les risques reliés à son travail et lui assurer la formation, l’entrainement et la supervision appropriés afin de faire en sorte que le travailleur ait l’habileté et les connaissances requises pour accomplir de façon sécuritaire le travail qui lui est confié.
Les obligations de l’employeur appellent à l’action devant les situations qui mettent le personnel à risque. En éducation, par exemple, un employeur pourrait devoir modifier l’organisation du travail plus d’une fois au cours d’une année scolaire, si elle risque d’être source de violence pour les travailleuses et travailleurs. Il en va de même pour l’aménagement des lieux ainsi que des méthodes et des techniques de travail (exemples : offrir de la formation pour être mieux à même d’intervenir dans des situations de violence, mettre en place des plans d’urgence et des plans de communication).
Ces obligations ont été confirmées à maintes reprises par les services d’inspectorat de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), notamment l’importance de s’assurer que toutes les travailleuses et tous les travailleurs sont bien informés et reçoivent la formation requise pour l’accomplissement de leurs tâches dans un contexte sécuritaire.
L’analyse du travail est cruciale afin de déceler les risques reliés à de possibles manifestations de violence. Pour ce faire, l’employeur ou l’établissement, selon le cas, doit :
- procéder à cette analyse, en collaboration avec le comité SST, les responsables en santé et sécurité, et l’ensemble des travailleuses et travailleurs;
- informer adéquatement le personnel sur les risques reliés à son travail;
- assurer la formation et la supervision appropriées (exemple : exercices de mesures de contrôle [arrêt d’agir]);
- aménager le lieu de travail de façon à ce que l’accès en soit contrôlé en tout temps;
- préparer et mettre à jour, périodiquement, un plan de mesures d’urgence et le faire connaitre à l’ensemble du personnel;
- tenir des exercices de simulation régulièrement;
- se doter d’une politique en matière de civilité, de harcèlement et de toute autre forme de violence, et la faire connaitre à l’ensemble du personnel et des personnes qui gravitent autour de l’école;
- mettre en œuvre des activités de sensibilisation, d’information et d’éducation de façon régulière (prévu dans la politique);
- appliquer les sanctions à l’encontre des responsables de comportements indésirables prévues dans la politique, s’il y a lieu.
-
En cas de situations de violence
Toute situation de violence nécessite la prise en charge des victimes et des témoins, ainsi que la mise en place de mesures pour éviter que la situation se reproduise.
Si la violence occasionne une invalidité, la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) offre des protections aux victimes. Cette loi définit l’accident du travail comme « un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail et qui entraine pour elle une lésion professionnelle » (Québec, 2025h) (blessure ou maladie). Le fait qu’un événement soit prévisible en théorie ne diminue aucunement son caractère imprévu et soudain lorsqu’il survient concrètement.
Déclarer une situation de violence peut faciliter la reconnaissance d’une lésion professionnelle et le versement de différentes indemnités par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). Hésiter à recourir à la Commission est souvent une erreur, car les droits de la LATMP sont souvent plus avantageux que bien d’autres, surtout à long terme.
Chaque situation de violence devrait faire l’objet d’une enquête ou, au minimum, d’une analyse approfondie afin d’en identifier les causes et les mesures à mettre en place pour prévenir leur répétition. Les représentantes et représentants en santé et sécurité (RSS) dans votre milieu sont désignés par la LSST pour effectuer de telles enquêtes et réaliser des inspections dans les milieux de travail.
La LATMP prévoit aussi des indemnités pour d’autres conséquences de l’accident du travail, comme une indemnité pour dommages corporels en cas d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychologique ou encore une indemnité couvrant en partie la réparation ou le remplacement des lunettes ou des vêtements endommagés.
Les frais d’assistance médicale requis par la lésion professionnelle, comme les médicaments, la physiothérapie, la psychothérapie, entre autres, sont totalement à la charge de la CNESST lorsque cette dernière accepte la réclamation. En cas de refus de la réclamation, adressez-vous immédiatement à votre syndicat, qui pourra vous orienter au regard des contestations.
Outils à télécharger

Guide de la CSQ
Pour éviter que la violence laisse des traces