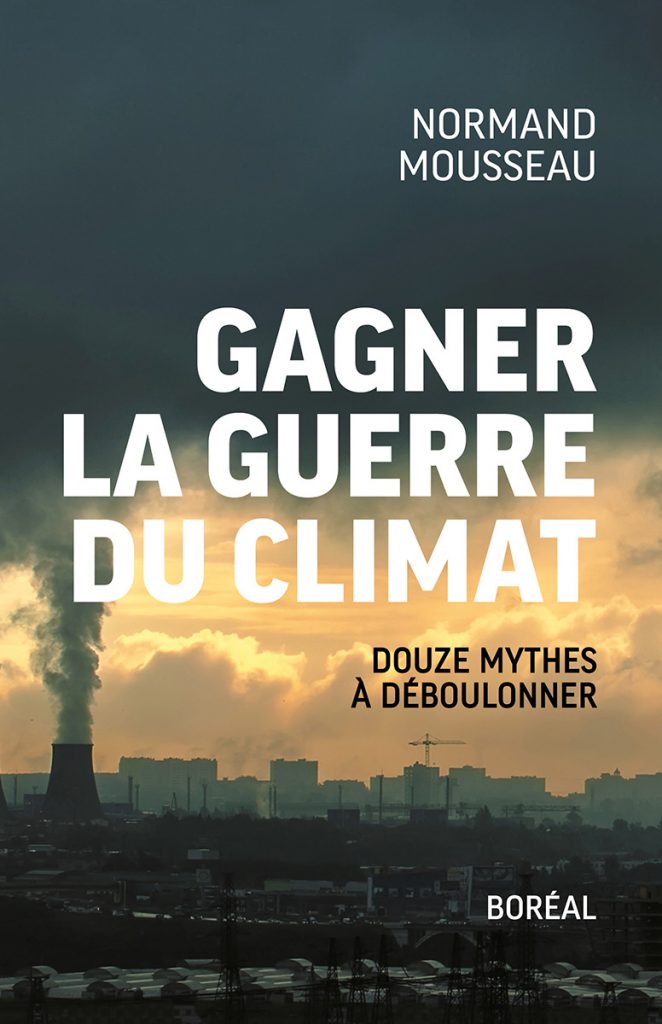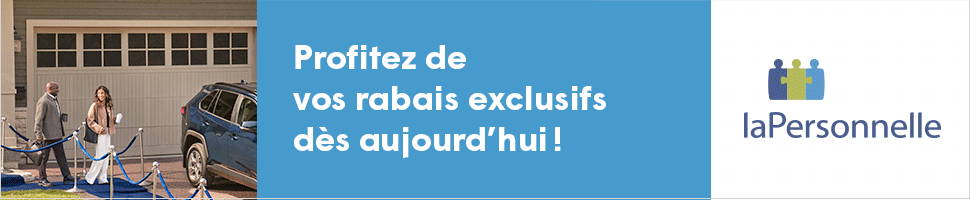Partout au Québec, des citoyennes et des citoyens se mobilisent, souvent avec succès, contre des géants de l’industrie des hydrocarbures. Cependant, la volonté de la municipalité de Ristigouche de protéger son territoire et son eau a mis en lumière le manque d’encadrement gouvernemental quant aux visées des compagnies sur notre sous-sol.
Patricia Posadas1 fait partie de celles et ceux qui se mobilisent. « Il faut s’interroger sur les dangers du transport, de l’exploration et de l’exploitation des hydrocarbures sur notre territoire. La fracturation hydraulique, qui sera nécessairement utilisée sur notre territoire, est extrêmement polluante et peut avoir des effets catastrophiques sur les nappes phréatiques », affirme-t-elle.

Repenser la transition énergétique
Enseignante en littérature au Cégep de Rimouski, Patricia Posadas milite à la fois au sein de son syndicat et de l’organisme Prospérité sans pétrole. Elle considère que son implication sociale et syndicale réunit l’ensemble de ses champs d’intérêt : la protection de l’environnement, le pacifisme et la justice sociale.
« Plutôt que de penser en termes de profits vite faits, mal faits, qui ont des impacts sur l’économie de proximité (le tourisme, l’agriculture, la pêche, etc.), il faut penser collectivement la transition énergétique qui va avoir lieu de toute façon. »
Normand Mousseau2, professeur de physique à l’Université de Montréal, considère qu’il est indispensable de proposer une vision plus globale pour Gagner la guerre du climat, titre de son dernier ouvrage sur le sujet. « Les enjeux environnementaux sont pensés en vase clos alors qu’ils sont trop complexes pour agir à la pièce. »
À titre d’exemple, il cite la contradiction entre les milliards dépensés par le Fonds vert, sous la direction du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), et les centaines de millions consacrés, par le même gouvernement, au développement de projets qui augmenteront les émissions de CO2, par le biais des investissements de la Caisse de dépôt et placement du Québec. C’est d’ailleurs l’une des raisons qui ont poussé les membres de la Fédération des enseignantes et enseignants de cégep (FEC-CSQ) à demander le retrait des investissements de la Caisse dans l’industrie des hydrocarbures.
Revoir la gouvernance environnementale
Actuellement, le transport est responsable de 43 % des émissions de CO2. Comment le gouvernement parviendra-t-il à atteindre ses objectifs de réduction de la consommation de pétrole de 40 % d’ici 2030, si les VUS arrivent toujours en tête des ventes de véhicules?
Malgré toutes les politiques et tous les organismes existants (Loi sur la qualité de l’environnement, Politique nationale de l’eau, Loi sur le développement durable, Fonds vert, etc.), le Québec n’a pas réussi à réduire suffisamment ses émissions de gaz à effet de serre (GES). L’adoption, sous le bâillon, de la Loi sur les hydrocarbures et les projets de règlements qui en découlent n’ont rien fait pour assurer la confiance du public.
En collaboration avec plusieurs experts, Normand Mousseau souhaite proposer une nouvelle manière de penser la gouvernance environnementale afin d’assurer une plus grande cohérence dans les décisions. « La question du développement durable est plus large que celle du changement climatique, car elle intègre aussi le développement économique et social. Le gouvernement devrait être capable de dire comment l’ensemble de ses politiques s’y intègrent. »
Dans le cadre de la campagne Le climat, l’État et nous, chapeautée par l’Institut du Nouveau Monde, les experts proposent notamment de créer un poste de ministre et une agence du développement durable, détachés du MDDELCC. « Il faut que l’on soit capable de proposer des projets structurants qui soutiennent les collectivités locales et améliorent la qualité de vie de la population », soutient le physicien.
Inscrire nos gestes dans l’action collective
Pour cet expert, il faut penser différemment. L’objectif n’est pas tant de mettre plus de voitures électriques sur les routes, mais bien de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Pour cela, il faut, entre autres, améliorer le transport en commun et favoriser les services de proximité dans les régions rurales. « Ce qui est certain, c’est que, pour que les actions individuelles ou ciblées fonctionnent, il faut qu’elles s’inscrivent dans une action collective », conclut-il.
1 Patricia Posadas est membre du Comité de coordination syndicale du Syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep de Rimouski (CSQ).
2 Normand Mousseau a coprésidé la Commission sur les enjeux énergétiques du Québec.
3 Carte des permis de recherche d’hydrocarbures au Québec
4 Carte des projets de transport pétrolier